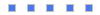

| Xavier Chanoine | 4.25  |
Oeuvre d'art |
| Ordell Robbie | 3.25 | Rêverie académique |


Avec Yumeji, Suzuki signe une oeuvre aussi exigeante que fascinante, foisonnante d'idées visuelles en tout genre et dressant le portrait d'un peintre très connu pour être un homme à femme (1884-1934) sans pour autant daigner les approcher d'avantage, du moins c'est ce que nous apprend la version de Suzuki. A la fois moderne (l'utilisation des revolvers) et rétro (costumes, époque oblige), le cadre développe la définition même du baroque teinté de théâtre. Cette théâtralité est à mettre à l'actif des décors et des situations (lorsque Sawada surjoue, les femmes prennent la pose) et bien que pur objet cinématographique, Yumeji est une pièce de théâtre, biographie décalée d'un artiste particulier et fascinant. A Suzuki à présent d'en tirer partie par l'intermédiaire de solutions visuelles sidérantes. Et en premier lieu la symbolique des corbeaux, récurrente et créant une rupture à la fois de rythme et de mise en scène car lorsqu'ils apparaissent (sous forme de marionnette) tout est fait pour casser la dynamique et passer à autre chose grâce à un montage séduisant et pas si courant. L'art des coupures franches.
Yumeji pousse même le vice jusqu'à jouer avec les codes du film en costume classique, qu'il soit dramatique, axé polar ou érotisme, pour jouer lui aussi avec son spectateur. Comment ne pas s'étonner devant ces soudaines ruptures de ton, le temps de voir un cheval courir au ralenti dans un pré, ou un samouraï à cheval chasser un homme, toujours au ralenti et sans la moindre prise de son (tout juste perçoit-on le bruits des sabots), tout comme ces dessins qui apparaissent comme pour symboliser le rêve, l'onirisme (Yume > rêve) et rappelant que Yumeji est un peintre de géni. Suzuki n'hésite pas non plus à filmer des pages et des pages de dessin (là aussi, rupture de rythme et de ton), confrontant le réel au fictif (la séquence d'intro avec le face à face à l'arme), cet ensemble contribue à rendre Yumeji en tout point extraordinaire et confirmer une nouvelle fois le talent encore intact de Suzuki. Sans pour autant être un pur exercice de style formel et sonore (Pistol Opera va encore plus loin), Yumeji vaut tout de même son pesant d'or car il est avant tout un véritable voyage à travers l'esprit torturé d'un cinéaste enfin libre depuis quelques années, capable de laisser libre cours à son imagination, rappelant parfois ce que faisait Kubrick (les nombreux passages silencieux de 2001, la seconde séquence du jeu de ballons rappelle la complexité/épure du cadre d'Orange Mécanique) sans forcément le citer.

Mais malgré ses quelques longueurs et sa tendance à l'endormissement, l'oeuvre de Suzuki joue de sa grâce (superbe thème d'Umebayashi repris dans In the Mood for Love, feuillages d'automne artificiels, superbes corps de femmes dénudés) et se contredit par l'association de séquences ridicules (la pendaison de fin, les boeufs), mais c'est cette contradiction à la fois formelle et fondamentale qui créent ce véritable projet artistique, car rarement aura t-on vu pareil rapprochement avec le théâtre. La complexité du cadre, les procédés narratifs complexes et totalement libres font de Yumeji à la fois l'une des oeuvres les plus intelligentes du début des années 90 et l'une des oeuvres les plus complexes du cinéma mondial d'un point de vu purement visuel et artistique. Au rayon nippon il y a peut-être Kurosawa et son Rêves qui peut se vanter d'être totalement à part sur le plan artistique (se fichant des codes imposés par le format cinéma), mais Yumeji semble encore plus torturé. A Suzuki de franchir encore un autre pas dix ans plus tard avec l'atypique mais très inégal Pistol Opera.
Quelques mots de Suzuki:
"Dans
Mélodie Tzigane, nous étions en présence d'un professeur. Dans Brumes de Chaleur, un homme de lettres. Ici, il s'agit d'un peintre. Dans ce film, j'ai voulu comme décor les rouges feuillages de l'automne que je suis allé photographier à Kanazawa. Dans les deux films précédents, j'avais choisi des cerisiers en fleurs. Mais cette année-là, le temps n'avait pas été propice à l'éclatement flamboyant des multiples nuances de rouges, des jaunes et des ocres de l'automne. Alors j'ai du me contenter de feuillages artificiels. Quelle tristesse! Pour la première fois, j'ai assisté à des auditions d'actrices pour le rôle principal. Je n'ai pas aimé cela du tout. La seule de bien que j'en ai retiré, c'est d'avoir pu travailler avec l'actrice Chikako Miyagi." ©Propos recueillis par Fabrice Arduini.
 Si les deux précédents volets de la Taisho Trilogy échappaient de justesse au risque de l'académisme, cette relecture de la vie du peintre et poète Yumeji Takehisa qu'est Yumeji ne l'évite cette fois pas. Malgré quelques trous narratifs quand meme bien moins déstabilisants que ceux des deux précédents volets, le film n'est cette fois pas aussi obscur en apparence que riche de sens. Ne se dégage ici que le portrait d'un peintre attiré par ses modèles féminins mais tout aussi incapable de les conquérir que d'affronter ses rivaux réels ou fantômatiques. Tout ceci renvoie à des thèmes du reste de la trilogie mais c'est comme si en se fondant dans le cadre de la biographie de peintre ils se transformaient en portes ouvertes sur la création artistique et le rapport d'un artiste aux femmes. Suzuki est en revanche plus convaincant les rares fois où il tente de traduire la création artistique de façon purement visuelle. Aux alternances de lenteur théâtrale et de ruptures de rythme des volets précédents s'est subsitué un montage plus quelconque.
Si les deux précédents volets de la Taisho Trilogy échappaient de justesse au risque de l'académisme, cette relecture de la vie du peintre et poète Yumeji Takehisa qu'est Yumeji ne l'évite cette fois pas. Malgré quelques trous narratifs quand meme bien moins déstabilisants que ceux des deux précédents volets, le film n'est cette fois pas aussi obscur en apparence que riche de sens. Ne se dégage ici que le portrait d'un peintre attiré par ses modèles féminins mais tout aussi incapable de les conquérir que d'affronter ses rivaux réels ou fantômatiques. Tout ceci renvoie à des thèmes du reste de la trilogie mais c'est comme si en se fondant dans le cadre de la biographie de peintre ils se transformaient en portes ouvertes sur la création artistique et le rapport d'un artiste aux femmes. Suzuki est en revanche plus convaincant les rares fois où il tente de traduire la création artistique de façon purement visuelle. Aux alternances de lenteur théâtrale et de ruptures de rythme des volets précédents s'est subsitué un montage plus quelconque.
 Et la forme oscille entre académisme planplan, effets de manche et trop attendu au vu du sujet (les plans cadrés comme des tableaux, route formelle mille fois parcourue par le genre de la biographie de peintre). Quant au score repris par Wong Kar-Wai pour son In the Mood for Love, son utilisation est également convenue. Malgré leur façade plus sage que les Suzuki des années 60, les deux précédents volets dynamitaient véritablement de l'intérieur leur classicisme formel. Cette fois, Suzuki se contente d'une traitement bien trop sage. Suzuki ne reviendra au format long que 10 ans après ce film montré à Cannes dans la catégorie Un Certain Regard avec un Pistol Opera qu'on pourrait voir comme une synthèse entre ses relectures surréalistes du polar des années 60 et les recherches formelles comme la reprise d'éléments plus traditionnellement japonais de la Taisho Trilogy.
Et la forme oscille entre académisme planplan, effets de manche et trop attendu au vu du sujet (les plans cadrés comme des tableaux, route formelle mille fois parcourue par le genre de la biographie de peintre). Quant au score repris par Wong Kar-Wai pour son In the Mood for Love, son utilisation est également convenue. Malgré leur façade plus sage que les Suzuki des années 60, les deux précédents volets dynamitaient véritablement de l'intérieur leur classicisme formel. Cette fois, Suzuki se contente d'une traitement bien trop sage. Suzuki ne reviendra au format long que 10 ans après ce film montré à Cannes dans la catégorie Un Certain Regard avec un Pistol Opera qu'on pourrait voir comme une synthèse entre ses relectures surréalistes du polar des années 60 et les recherches formelles comme la reprise d'éléments plus traditionnellement japonais de la Taisho Trilogy.
Mais malgré leurs qualités, ces oeuvres de seconde partie de carrière réalisées en toute liberté artistique sont loin de valoir les chefs d'oeuvre suzukiens de l'époque des studios. Comme si l'un des cinéastes japonais les plus iconoclastes du demi-siècle passé n'avait pu donner la pleine mesure de son talent que dans le cadre le plus contraignant qui soit...


