ma note
-/5
Merci de vous logguer pour voir votre note, l'ajouter ou la modifier!
moyenne
3.54/5
Une Auberge à Tokyo
les avis de Cinemasie
3 critiques: 3.92/5
vos avis
9 critiques: 3.81/5
Chiens et Hommes errants...
Et si la mise en scène d'Ozu annonce dans les grandes lignes son cinéma si passionnant à venir, en dehors de ses quelques travellings synonymes de la grandeur de son cinéma passé, sa thématique reste ancrée dans sa première Histoire. On retrouve l'excellent Sakamoto Takashi dans la peau d'un père errant en compagnie de ses deux enfants, recherchant le premier travail venu. Il faut bien dire que cet Ozu dose les émotions avec une telle minutie qu'il ne tombe jamais dans le larmoyant facile et le pittoresque d'époque. On peut effectivement rire du tirage de langue des gosses, ou de la bonne bouille du père au sourire immense et un peu benêt lorsque ses enfants trouvent le moyen de rapporter quelques sous, comme cette chasse au chien errant, reflet de la propre condition des personnages livrés à leur sort dans une société parfois renfermée. Il est aussi intéressant de voir l'optimisme à la limite du romantique d'un Ozu pas tout à fait en accord avec la trame de ses futurs chefs d'oeuvre : ici, la veuve et sa petite fille malade ne sont pas les personnages les plus importants du récit, mais ils permettent de le fluidifier plus encore, d'y apporter une certaine forme d'humanisme dans ce régime bien pauvre. Ainsi, les liens se nouent, les deux "couples" passent plus de temps ensemble, jusqu'à ce que la petite finisse par tomber malade. Le Ozu larmoyant n'est pas loin, mais il se détache par l'action particulièrement humaine du père des deux gosses, en fin de métrage, évitant ainsi le piège lacrymal potentiel du fait d'un score tirant le film vers des sphères mélodramatiques.
Une perle cinématographique à la fraîcheur intacte
 Etonnant Ozu. Parce que la découverte de cette Auberge à Tokyo est un joli choc pour qui ne connaissait que le Ozu cinéaste de l’age d’or du cinéma japonais qui inspira pour le meilleur –Kitano, HHH- comme pour le pire –les cinéastes asiatiques de festival camouflant leur absence de projet de mise en scène derrière un choix contemplatif, une certaine critique tombant à tous les coups dans le panneau en trouvant un sens culturel à ce choix-là là où il n’y a que vide se revendiquant comme de l’art- tout un versant du cinéma d’auteur asiatique. Parce qu’avant d’etre ce cinéaste « typiquement japonais » -comme si Kurosawa, Fukasaku ou Suzuki ne l’étaient pas- Ozu fut aussi néoréaliste avant l’heure. Le jeu des acteurs est retenu, nuancé, d’un naturel et d’une spontanéité annonçant le néoréalisme comme la Nouvelle Vague. Spontanéité est aussi le terme pouvant caractériser la construction narrative du film : l’errance d’un père et de ses deux enfants est l’occasion de rencontres, de croisements –croiser une femme que l’on connaît, croiser une mère et sa fille ayant aussi à subir les conséquences de la crise- sans pour autant que cela donne une impression de dispositif visible comme parfois chez certains (grands) cinéastes asiatiques actuels –Tsai, Wong Kar Wai, Hong Sang Soo-, l’effet produit étant du coup plus puissant. Quant à la mise en scène, si elle n’essaie pas encore le plus souvent de faire sens culturellement –à part quelques plans à hauteur de tatami- comme ce sera le cas par la suite chez le cinéaste, elle est déjà le plus souvent contemplative, utilise très bien les changements de perspective pour dynamiser le récit. Le montage n’est pas ultrarapide mais ne cherche pas non plus à faire ressentir la durée, il semble couler de source. Et toujours au rayon des évidences la façon tout à fait naturelle dont le film bascule sur la fin dans le mélodrame, l’intensité dramatique monte d’un cran sans pour autant atteindre le niveau qu’elle peut avoir chez un cinéaste tel que Sirk et du coup le changement brusque ne paraît pas forcé, le basculement se fait avec un naturel confondant. Et c’est pourtant l’un des derniers films de la période muette du cinéaste, un cinéaste qui vu la quantité de film qu’il avait déjà derrière lui pourrait etre conscient de ses effets mais réalise un véritable premier film, un de ces classiques réalisés sans la conscience de faire un coup d’éclat tels que le seront les premiers films des Nouvelles Vagues.
Etonnant Ozu. Parce que la découverte de cette Auberge à Tokyo est un joli choc pour qui ne connaissait que le Ozu cinéaste de l’age d’or du cinéma japonais qui inspira pour le meilleur –Kitano, HHH- comme pour le pire –les cinéastes asiatiques de festival camouflant leur absence de projet de mise en scène derrière un choix contemplatif, une certaine critique tombant à tous les coups dans le panneau en trouvant un sens culturel à ce choix-là là où il n’y a que vide se revendiquant comme de l’art- tout un versant du cinéma d’auteur asiatique. Parce qu’avant d’etre ce cinéaste « typiquement japonais » -comme si Kurosawa, Fukasaku ou Suzuki ne l’étaient pas- Ozu fut aussi néoréaliste avant l’heure. Le jeu des acteurs est retenu, nuancé, d’un naturel et d’une spontanéité annonçant le néoréalisme comme la Nouvelle Vague. Spontanéité est aussi le terme pouvant caractériser la construction narrative du film : l’errance d’un père et de ses deux enfants est l’occasion de rencontres, de croisements –croiser une femme que l’on connaît, croiser une mère et sa fille ayant aussi à subir les conséquences de la crise- sans pour autant que cela donne une impression de dispositif visible comme parfois chez certains (grands) cinéastes asiatiques actuels –Tsai, Wong Kar Wai, Hong Sang Soo-, l’effet produit étant du coup plus puissant. Quant à la mise en scène, si elle n’essaie pas encore le plus souvent de faire sens culturellement –à part quelques plans à hauteur de tatami- comme ce sera le cas par la suite chez le cinéaste, elle est déjà le plus souvent contemplative, utilise très bien les changements de perspective pour dynamiser le récit. Le montage n’est pas ultrarapide mais ne cherche pas non plus à faire ressentir la durée, il semble couler de source. Et toujours au rayon des évidences la façon tout à fait naturelle dont le film bascule sur la fin dans le mélodrame, l’intensité dramatique monte d’un cran sans pour autant atteindre le niveau qu’elle peut avoir chez un cinéaste tel que Sirk et du coup le changement brusque ne paraît pas forcé, le basculement se fait avec un naturel confondant. Et c’est pourtant l’un des derniers films de la période muette du cinéaste, un cinéaste qui vu la quantité de film qu’il avait déjà derrière lui pourrait etre conscient de ses effets mais réalise un véritable premier film, un de ces classiques réalisés sans la conscience de faire un coup d’éclat tels que le seront les premiers films des Nouvelles Vagues.
Au fond du trou
Une Auberge à Tokyo est un très beau film sur un sujet difficile, la pauvreté et l’exclusion, cette épée de Damoclès qui ferait peur à 50% des français : un père au chômage, 2 enfants à charge, la rue pour seul horizon, la chasse aux chiens errants comme seul espoir de revenu pour manger et/ou s’abriter le soir,… Bigre, c’est pas gai, d’autant que la magnifique musique accompagnant les images de ce muet n’est pas franchement joyeuse. Heureusement, Ozu ne tire ni vers le lacrymal ni vers la victimisation : le père est certes abattu et sans illusions, mais ses 2 fils se battent pour survivre, l’encouragent, le poussent à trouver un emploi ; et la solidarité a encore une signification, notamment entre personnes de même condition (cf. la mère et sa fille).
Très facile à suivre, touchant et encore d’actualité, cette œuvre de plus de 70 ans d’âge a sa place dans la liste des réussites de la carrière d’Ozu.
The Kids
Du néoréalisme avant l'heure avec une petite touche de Chaplin (misère sociale et mélodrame, duo comique récurrent des deux petits garçons). L'arrière plan est celui de la crise des années 30 : ouvriers au chômage, soupes populaires et auberges bon marché. C'est le Japon d'avant la crise militariste et d'avant les salarymen. Dans la même veine, on peut préférer La femme de Tokyo, plus ramassé et plus poignant, je trouve.
Limpide 
Un film muet vraiment magnifique, qui n'a rien à envier à nos chefs d'oeuvre occidentaux! Le néo-réalisme avant l'heure.
A noter que contrairement à d'autres Ozu muets (tous?), Une Auberge à Tokyo a une bande son, à pleurer d'ailleurs!
Bref, à voir absolument.
Demain nous réussirons
Dernier film muet d'Ozu avec son documentaire
La Danse du Lion tourné à la même époque, ce drame social sur un chômeur tokyoïte flanqué de ses deux gosses gagne en maturité par rapport aux précédentes œuvres du cinéaste et annonce d'une certaine manière le courant néoréaliste qui florira en Italie dans les années 40 et 50, de Rossellini à De Sica, de
Rome Ville Ouverte au
Voleur de Bicyclette. Il y a plusieurs passages magnifiques dans cette bande d'une heure et des poussières, à commencer par les échanges entre les deux gamins (Ozu se montrait excellent pour diriger les comédiens en culottes courtes) et les scènes avec leur père où tous les trois, affamés, se miment un gueuleton. On pourra regretter un rythme en dents de scie (si les derniers grands opus du réalisateur adopteront un tempo bien plus lent, celui-ci sera également plus homogène) avec un début mouvementé mais des séquences finales qui s'éternisent et, dans une moindre mesure, un excès de cartons qui donne à l'ensemble un côté trop explicatif – une des forces du cinéma muet étant de laisser les images parler d'elles-mêmes. Ça reste un beau film que l'on peut situer sur une croisée de la carrière d'Ozu, à mi-chemin entre ses premières bluettes bourrées d'énergie et ses futurs chefs-d'œuvre au caractère plus apaisé.
Voleur d'oeuf à l'effet de boeuf
Incroyable redécouverte d'un authentique chef-d'oeuvre du grand cinéaste talentueux et le parfait croisement de ses premiers films avec ses futurs métrages.
Il est tout de même à se demander, si l'accompagnement musical de la version proposée par l'ancien éditeur "Ciné Horizon" sur le film ne fausse quelque part le jugement des autres premiers métrages du cinéaste parus dans la même collection et dépourvus du moindre son. Si le silence total demande un vrai temps d'adaptation à nos oreilles gâtées par l'actuelle surenchère du travail sur le son et la musique, rien que l'accompagnement en lien avec les images donne déjà une toute autre perspective, ouvrant grand la voie sur une interprétation donnée. De grande qualité, la gaieté des notes sur les enfants rend les personnages immédiatement sympathiques; plus tard, la surdité et mélancolie des notes plaintives dans les moments plus difficiles conditionnent forcément l'humeur du spectateur à sentir de même...
Néanmoins, le film se tient en lui-même et étonne encore aujourd'hui aussi bien par sa redoutable fluidité, que par les prémices d'éléments typiquement OZU-iens.
Tout d'abord, le cinéaste toujours été particulièrement inspiré par le travail avec les enfants. Que ce soit dans ses "Gosses de Tokyo", "Récit d'une propriétaire" ou - bien plus tard - son "Bonjour", les gamins lui ont toujours inspiré maintes scènes renouvelées aussi bien comiques, que tendres. Un régal.
La trame narrative est d'une limpidité rarement atteint dans son oeuvre jusqu'à présent et ne s'embarrasse plus ni des longueurs dramatiques pour appuyer la mélancolie, ni des descriptions alambiquées pour exprimer de vrais sentiments. Il n'y a qu'à voir la dernière scène du vol commis par le père, largement inspiré par la scène de "Femmes et voyous" (néons y compris) pour mesurer l'évolution de la maîtrise du cinéaste en seulement quelques mois.
Enfin, OZU explore toujours davantage ce qui deviendront plus tard de caractéristiques typiques de son oeuvre : plans à ras le tatami, plans d'inserts pour rompre le rythme de son récit et instaurer une ambiance particulière et une économie de mouvements pour coller au plus près de la réalité des choses.
Drôle et enlevée (les enfants et leur rapport avec leur père), en même temps que grave et dramatique (la fragile situation économique du Japon; l'histoire de la femme et de son enfant; la fin), OZU réalise là l'un de ses premiers authentiques chef-d'oeuvres, qui n'a rien perdu de sa verve de nos jours.
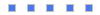

 Etonnant Ozu. Parce que la découverte de cette Auberge à Tokyo est un joli choc pour qui ne connaissait que le Ozu cinéaste de l’age d’or du cinéma japonais qui inspira pour le meilleur –Kitano, HHH- comme pour le pire –les cinéastes asiatiques de festival camouflant leur absence de projet de mise en scène derrière un choix contemplatif, une certaine critique tombant à tous les coups dans le panneau en trouvant un sens culturel à ce choix-là là où il n’y a que vide se revendiquant comme de l’art- tout un versant du cinéma d’auteur asiatique. Parce qu’avant d’etre ce cinéaste « typiquement japonais » -comme si Kurosawa, Fukasaku ou Suzuki ne l’étaient pas- Ozu fut aussi néoréaliste avant l’heure. Le jeu des acteurs est retenu, nuancé, d’un naturel et d’une spontanéité annonçant le néoréalisme comme la Nouvelle Vague. Spontanéité est aussi le terme pouvant caractériser la construction narrative du film : l’errance d’un père et de ses deux enfants est l’occasion de rencontres, de croisements –croiser une femme que l’on connaît, croiser une mère et sa fille ayant aussi à subir les conséquences de la crise- sans pour autant que cela donne une impression de dispositif visible comme parfois chez certains (grands) cinéastes asiatiques actuels –Tsai, Wong Kar Wai, Hong Sang Soo-, l’effet produit étant du coup plus puissant. Quant à la mise en scène, si elle n’essaie pas encore le plus souvent de faire sens culturellement –à part quelques plans à hauteur de tatami- comme ce sera le cas par la suite chez le cinéaste, elle est déjà le plus souvent contemplative, utilise très bien les changements de perspective pour dynamiser le récit. Le montage n’est pas ultrarapide mais ne cherche pas non plus à faire ressentir la durée, il semble couler de source. Et toujours au rayon des évidences la façon tout à fait naturelle dont le film bascule sur la fin dans le mélodrame, l’intensité dramatique monte d’un cran sans pour autant atteindre le niveau qu’elle peut avoir chez un cinéaste tel que Sirk et du coup le changement brusque ne paraît pas forcé, le basculement se fait avec un naturel confondant. Et c’est pourtant l’un des derniers films de la période muette du cinéaste, un cinéaste qui vu la quantité de film qu’il avait déjà derrière lui pourrait etre conscient de ses effets mais réalise un véritable premier film, un de ces classiques réalisés sans la conscience de faire un coup d’éclat tels que le seront les premiers films des Nouvelles Vagues.
Etonnant Ozu. Parce que la découverte de cette Auberge à Tokyo est un joli choc pour qui ne connaissait que le Ozu cinéaste de l’age d’or du cinéma japonais qui inspira pour le meilleur –Kitano, HHH- comme pour le pire –les cinéastes asiatiques de festival camouflant leur absence de projet de mise en scène derrière un choix contemplatif, une certaine critique tombant à tous les coups dans le panneau en trouvant un sens culturel à ce choix-là là où il n’y a que vide se revendiquant comme de l’art- tout un versant du cinéma d’auteur asiatique. Parce qu’avant d’etre ce cinéaste « typiquement japonais » -comme si Kurosawa, Fukasaku ou Suzuki ne l’étaient pas- Ozu fut aussi néoréaliste avant l’heure. Le jeu des acteurs est retenu, nuancé, d’un naturel et d’une spontanéité annonçant le néoréalisme comme la Nouvelle Vague. Spontanéité est aussi le terme pouvant caractériser la construction narrative du film : l’errance d’un père et de ses deux enfants est l’occasion de rencontres, de croisements –croiser une femme que l’on connaît, croiser une mère et sa fille ayant aussi à subir les conséquences de la crise- sans pour autant que cela donne une impression de dispositif visible comme parfois chez certains (grands) cinéastes asiatiques actuels –Tsai, Wong Kar Wai, Hong Sang Soo-, l’effet produit étant du coup plus puissant. Quant à la mise en scène, si elle n’essaie pas encore le plus souvent de faire sens culturellement –à part quelques plans à hauteur de tatami- comme ce sera le cas par la suite chez le cinéaste, elle est déjà le plus souvent contemplative, utilise très bien les changements de perspective pour dynamiser le récit. Le montage n’est pas ultrarapide mais ne cherche pas non plus à faire ressentir la durée, il semble couler de source. Et toujours au rayon des évidences la façon tout à fait naturelle dont le film bascule sur la fin dans le mélodrame, l’intensité dramatique monte d’un cran sans pour autant atteindre le niveau qu’elle peut avoir chez un cinéaste tel que Sirk et du coup le changement brusque ne paraît pas forcé, le basculement se fait avec un naturel confondant. Et c’est pourtant l’un des derniers films de la période muette du cinéaste, un cinéaste qui vu la quantité de film qu’il avait déjà derrière lui pourrait etre conscient de ses effets mais réalise un véritable premier film, un de ces classiques réalisés sans la conscience de faire un coup d’éclat tels que le seront les premiers films des Nouvelles Vagues.