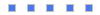

| MLF | 4 | |
| Arno Ching-wan | 4.25  |
Vintage intemporel, ou quand 2001 meets Fantasia au Japon |

 On en connaît un paquet de Phœnix(s). Le qui, armuré de la tête aux pieds, passe son temps à sauver son frère, celui qui chante et fricote avec Sofia Coppola, le qui Arizona, le qui « on » fait Nixon, le qui donne des ordres à Harry Potter etc. Le plus célèbre, surtout au Japon, c’est celui d’Osamu Tezuka. Le manga « Phoenix » représente son œuvre la plus dense, la plus ambitieuse, la plus riche et, de ce fait, la moins terminée. Normal : le phœnix renaît de ses cendres et Osamu Tezuka, aussi grand soit-il, n’a pas pu le suivre sur ce coup là. Ca coince à un moment, forcément. Et ce moment survint en 1989, année de la disparition du maître après 35 années consacrées épisodiquement à cette chose toute personnelle. Cet oiseau, de malheur ou de bon augure peut sans peine fusionner avec certaines visions bouddhistes, observant et interagissant – plus ou moins – avec les cycles de réincarnation et chutes de diverses civilisations et espèces. Les actions d’un individuel vivant déterminant, en partie, sa vie future. Le fil rouge infini d’une histoire non finie.
On en connaît un paquet de Phœnix(s). Le qui, armuré de la tête aux pieds, passe son temps à sauver son frère, celui qui chante et fricote avec Sofia Coppola, le qui Arizona, le qui « on » fait Nixon, le qui donne des ordres à Harry Potter etc. Le plus célèbre, surtout au Japon, c’est celui d’Osamu Tezuka. Le manga « Phoenix » représente son œuvre la plus dense, la plus ambitieuse, la plus riche et, de ce fait, la moins terminée. Normal : le phœnix renaît de ses cendres et Osamu Tezuka, aussi grand soit-il, n’a pas pu le suivre sur ce coup là. Ca coince à un moment, forcément. Et ce moment survint en 1989, année de la disparition du maître après 35 années consacrées épisodiquement à cette chose toute personnelle. Cet oiseau, de malheur ou de bon augure peut sans peine fusionner avec certaines visions bouddhistes, observant et interagissant – plus ou moins – avec les cycles de réincarnation et chutes de diverses civilisations et espèces. Les actions d’un individuel vivant déterminant, en partie, sa vie future. Le fil rouge infini d’une histoire non finie.
 Deux ans après la version du chapitre de l’Aube, film semi-live chapeauté par le cinéaste membre du « clan des bérets » Kon Ichikawa, et 6 ans avant le chapitre de « Ho-o » réalisé par l’élève Rin Taro, voici venir à nos yeux Phénix, l'oiseau de feu, gros budget de l'époque distribué en VHS en France il y a longtemps de cela sous le titre formidablement nul : Les vengeurs de l’espace. Réalisé par Suguru Sugiyama, à qui l’on doit… pas grand-chose. Peu importe, le Dieu Tezuka, encore vivant à cette époque, menait la danse.
Deux ans après la version du chapitre de l’Aube, film semi-live chapeauté par le cinéaste membre du « clan des bérets » Kon Ichikawa, et 6 ans avant le chapitre de « Ho-o » réalisé par l’élève Rin Taro, voici venir à nos yeux Phénix, l'oiseau de feu, gros budget de l'époque distribué en VHS en France il y a longtemps de cela sous le titre formidablement nul : Les vengeurs de l’espace. Réalisé par Suguru Sugiyama, à qui l’on doit… pas grand-chose. Peu importe, le Dieu Tezuka, encore vivant à cette époque, menait la danse.
Voici le genre de films que l’on devait aimer vanner à sa sortie et qui, maintenant, fait franchement plaisir à voir. Malgré ses nombreux « défauts », à savoir une influence du Fantasia de Disney pas toujours bien digérée, une rythmique laissant à désirer et une narration par conséquent assez chaotique, tares faisant maintenant office de traits de caractère plaisants, on se laisse emporter, les yeux brillants, par cette histoire d’amour formidable et ce conte à ce point ambitieux que le fond parvient, au final, à dominer une forme inégale. L'œuvre est tellement sincère qu’elle nous absorbe dans sa cause aussi facilement qu'un gamin le ferait en nous emmenant par la main aller voir le zoli caillou, là, par terre. Pas si joli que ça le caillou, évidemment, mais l'instant n'en obtient pas moins une magie indéniable. Non? Ah bon.
 En choisissant de suivre à la trace son héros, caillou par caillou semé, de sa naissance à sa (re)naissance en passant accessoirement par sa mort et un gros spoiler, c’est dans son introduction que le film réussi le mieux son coup. Les 10 premières minutes sont parfaites : l’aspect musical est merveilleux, la naissance dansante du bébé éprouvette évoque immédiatement la littérature d’Aldous Huxley, en même temps qu'un peu plus tard, à la faveur d'une dualité fraternelle, le film Bienvenue à Gattaca. Les images sont là parfaitement synchrones avec la composition grandiose de Yasuo Higuchi. Le film prend son temps, sereinement, via cette semi comédie musicale nous montrant la frivolité naïve d’une enfance innocente. L’appellation « classique de l’anticipation » s’imprègne déjà dans un bout du cortex du spectateur. Pour après se diluer. On se fait ensuite balader par les exploits du robot nounou, une jolie blonde métallique et transformable folle amoureuse du héros Godo; des peluches made in Disney se mettent à danser, nettement moins synchro malheureusement qu'au tout début, avec qui plus est une propension certaine à semer des cheveux sur une jolie soupe n’en demandant pas tant. Jusqu'à ce qu'un phoenix magnifique vienne déployer ses ailes en enveloppant intégralement nos yeux de sa magnificence aveuglante, renforcé qu’il est par ses nombreux avatars venus perturber notre volonté d'adaptation. Le perpétuel mouvement, le perpétuel changement et l’impossible assimilation. La divinité du monstre est incroyablement bien rendue, qu’elle nous soit présentée comme une horreur impitoyable ou une inoffensive créature craquante qu’on aimerait tant serrer dans nos bras câlins.
En choisissant de suivre à la trace son héros, caillou par caillou semé, de sa naissance à sa (re)naissance en passant accessoirement par sa mort et un gros spoiler, c’est dans son introduction que le film réussi le mieux son coup. Les 10 premières minutes sont parfaites : l’aspect musical est merveilleux, la naissance dansante du bébé éprouvette évoque immédiatement la littérature d’Aldous Huxley, en même temps qu'un peu plus tard, à la faveur d'une dualité fraternelle, le film Bienvenue à Gattaca. Les images sont là parfaitement synchrones avec la composition grandiose de Yasuo Higuchi. Le film prend son temps, sereinement, via cette semi comédie musicale nous montrant la frivolité naïve d’une enfance innocente. L’appellation « classique de l’anticipation » s’imprègne déjà dans un bout du cortex du spectateur. Pour après se diluer. On se fait ensuite balader par les exploits du robot nounou, une jolie blonde métallique et transformable folle amoureuse du héros Godo; des peluches made in Disney se mettent à danser, nettement moins synchro malheureusement qu'au tout début, avec qui plus est une propension certaine à semer des cheveux sur une jolie soupe n’en demandant pas tant. Jusqu'à ce qu'un phoenix magnifique vienne déployer ses ailes en enveloppant intégralement nos yeux de sa magnificence aveuglante, renforcé qu’il est par ses nombreux avatars venus perturber notre volonté d'adaptation. Le perpétuel mouvement, le perpétuel changement et l’impossible assimilation. La divinité du monstre est incroyablement bien rendue, qu’elle nous soit présentée comme une horreur impitoyable ou une inoffensive créature craquante qu’on aimerait tant serrer dans nos bras câlins.
 La musique revêt une importance capitale, primant sur les bruits et onomatopées habituellement de rigueur. L’orchestre étouffe le plus souvent entrechocs et autres bruits de pas, transformant l'oeuvre en illustration visuelle d’un trip musical élaboré en amont. Ce qui n’est pas le cas, mais la fascination de Tezuka pour Fantasia a abouti à cet état de fait, non rédhibitoire pour les moins jeunes, une sorte de conte de space opera empruntant à une mise en image de type Pierre et le Loup sa narration bucolique surannée. Sur deux heures de films, à cette musique d'être parfois trop envahissante. Le défaut d'une qualité: la musique fut composée pour ce film quand Fantasia piochait dans des classiques inattaquables. 40 ans plus tôt, certes. Ce Phénix là est inabouti, inachevé, bancal, des éléments manquent pour en faire un de ces films figurant dans le Top 100 des meilleurs films du monde. Vous savez, ces films qui vous semblent à ce point parfaits que jamais vous n'avez envie de les revoir. Etre imparfait et sincère, c'est tendre vers la perfection. A ce film ci d'être un beau chemin ayant pour extrémité un bien bel objectif. Il est pour le moins plaisant de l'emprunter.
La musique revêt une importance capitale, primant sur les bruits et onomatopées habituellement de rigueur. L’orchestre étouffe le plus souvent entrechocs et autres bruits de pas, transformant l'oeuvre en illustration visuelle d’un trip musical élaboré en amont. Ce qui n’est pas le cas, mais la fascination de Tezuka pour Fantasia a abouti à cet état de fait, non rédhibitoire pour les moins jeunes, une sorte de conte de space opera empruntant à une mise en image de type Pierre et le Loup sa narration bucolique surannée. Sur deux heures de films, à cette musique d'être parfois trop envahissante. Le défaut d'une qualité: la musique fut composée pour ce film quand Fantasia piochait dans des classiques inattaquables. 40 ans plus tôt, certes. Ce Phénix là est inabouti, inachevé, bancal, des éléments manquent pour en faire un de ces films figurant dans le Top 100 des meilleurs films du monde. Vous savez, ces films qui vous semblent à ce point parfaits que jamais vous n'avez envie de les revoir. Etre imparfait et sincère, c'est tendre vers la perfection. A ce film ci d'être un beau chemin ayant pour extrémité un bien bel objectif. Il est pour le moins plaisant de l'emprunter.


