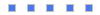Dark water
Tsai Ming-Liang réussit à rendre son récit troublant et dérangeant, avec une absence totale de moyens, une récurrente au cours de sa filmographie. Armé de sa caméra terriblement voyeuse sans pour autant faire preuve ici d'une certaine complaisance face au "corps malade", il réussit ce qu'il entreprendra avec échec dans
I don’t want to sleep alone, c'est à dire porter un regard lucide sur un cercle de personnes laissées à l'abandon, dans une société qui ne tolère rien de déplacé. C'est pourquoi, le père homosexuel refoulé se terre comme un rat dans les cabines de bain public en attendant l'arrivé d'une personne aux convictions sexuelles identiques, la mère passe son temps dans les ascenseurs et voit en elle une passion pour les films pornographiques nippons, et le fils, courbaturé depuis sa "guest apparition" en tant que cadavre dans un film fauché, ère dans les rues de Taipei à bord de son scooter ancestral. Ce qui est intéressant ici c'est donc ce basculement terrifiant, ce changement de ton désespéré qu'entretient Tsai Ming-Liang au cours des deux heures éprouvantes : Kang-Sheng montre un visage rayonnant en première partie de métrage, lorsqu'il dévale les rues à bord de sa moto comme un véritable "jeune" dans l'ère du temps, et semble se recroqueviller sur lui-même lorsque sa pathologie non identifiable prend le dessus. Le beau gosse "moderne" se transforme donc peu à peu en personnage maigrelet, chauve comme un moine Shaolin, aux mouvements de tête incessants, personnage complètement rongé par la maladie qu'une séance d'exorcisme ne peut bien entendu pas guérir.
Une thématique chère au cinéaste, qui semble ici prendre une toute autre dimension tant son approche viscérale de la maladie rend le spectateur à son tour malade. Et si la maladie occupe une place importante dans The river, l'eau y a clairement déposé ses bagages : inondations alarmantes au niveau du plafond ou sur le sol, personnages se désaltérant très souvent, pluies diluviennes. Au spectateur à présent de se sentir pleinement concerné par ce que propose Tsai, et si le cinéaste assomme par ses plans fixes interminables et particulièrement silencieux, c'est pour asseoir un malaise pleinement ancré dans cette société chinoise, aux mains de personnes complètement dépassées par les évènements et qui ne savent plus très bien faire la part des choses et se reconnaître, en témoigne cette séquence honteuse où le père ne sait même pas qu'il masturbe son fils dans une cabine sombre et étroite. Le bilan de The river est donc mitigé, et si les intentions du cinéaste dans sa démarche de dénoncer la société sont plutôt bonnes, rien ne justifie ce trop plein auteurisant, marque de fabrique aussi bien fascinante que pénible sur la durée.
Optimisme paradoxal
 Ce qui est paradoxal dans la Rivière, c'est que c'est à la fois le film le plus optimiste et le plus désespéré de Tsai. Qu'en supprimant l'humour présent dans Vive l'Amour, en rendant son film plus étouffé il crée une porte de sortie pour ses personnages. Le mal de dos du début a ainsi deux explications possibles: soit il provient du fait d'avoir joué les cadavres pour un film d'Ann Hui et dès lors c'est en jouant son propre rôle au cinéma que Hsiao Kang prend conscience de ce que sa vie est devenue -très intéréssant car d'habitude l'acteur va plutot chercher dans son existence des éléments pour jouer son rôle-; soit il proviendrait d'une expérience hétérosexuelle et le mal de dos sanctionnerait la tentative de Hsiao Kang de rentrer dans la norme comme son père, ce qui se défend aussi vu que Tsai dit dans ses interviews qu'"on ne sait jamais vraiment si Hsiao Kang est homosexuel". Personnellement, je pencherai plutôt pour la première car elle est plus directement liée au récit et ouvre une réflexion passionnante sur la frontière cinéma/réalité. La joie que trouvent les personnages de la Rivière c'est un peu celle dont Léonard Cohen parlait en interview: "Le pessimiste, c'est celui qui attend la pluie mais moi je suis mouillé jusqu'aux os." (d'ailleurs les fuites d'appartements aboutissent à des inondations annonçant le déluge libérateur de the Hole ce qui renforce les connections entre le taiwanais et le génial canadien sur ce point). En poussant son fameux dispositif au point de non-retour, Tsai rend son film encore plus imprévisible, l'amène jusqu'à l'explosion pour trouver une porte de sortie. Cette porte de sortie, c'est le contact de la scène finale du sauna qui confronte père et fils à la vérité de leur existence, qui fait exploser le malaise ressenti durant tout le film par le spectateur. Le film peut alors s'achever par un plan de Lee Kang Sheng surmontant sa douleur pour contempler l'immensité urbaine (là où Vive l'amour se terminait sur une fille en pleurs). En radicalisant l'approche des Rebelles du Dieu Néon, Tsai trouve le véritable trou d'air dans son cinéma. En se mettant au pied du mur, il trouve la voie vers un renouveau confirmé par la suite de sa filmographie où il aèrera fortement son dispositif.
Ce qui est paradoxal dans la Rivière, c'est que c'est à la fois le film le plus optimiste et le plus désespéré de Tsai. Qu'en supprimant l'humour présent dans Vive l'Amour, en rendant son film plus étouffé il crée une porte de sortie pour ses personnages. Le mal de dos du début a ainsi deux explications possibles: soit il provient du fait d'avoir joué les cadavres pour un film d'Ann Hui et dès lors c'est en jouant son propre rôle au cinéma que Hsiao Kang prend conscience de ce que sa vie est devenue -très intéréssant car d'habitude l'acteur va plutot chercher dans son existence des éléments pour jouer son rôle-; soit il proviendrait d'une expérience hétérosexuelle et le mal de dos sanctionnerait la tentative de Hsiao Kang de rentrer dans la norme comme son père, ce qui se défend aussi vu que Tsai dit dans ses interviews qu'"on ne sait jamais vraiment si Hsiao Kang est homosexuel". Personnellement, je pencherai plutôt pour la première car elle est plus directement liée au récit et ouvre une réflexion passionnante sur la frontière cinéma/réalité. La joie que trouvent les personnages de la Rivière c'est un peu celle dont Léonard Cohen parlait en interview: "Le pessimiste, c'est celui qui attend la pluie mais moi je suis mouillé jusqu'aux os." (d'ailleurs les fuites d'appartements aboutissent à des inondations annonçant le déluge libérateur de the Hole ce qui renforce les connections entre le taiwanais et le génial canadien sur ce point). En poussant son fameux dispositif au point de non-retour, Tsai rend son film encore plus imprévisible, l'amène jusqu'à l'explosion pour trouver une porte de sortie. Cette porte de sortie, c'est le contact de la scène finale du sauna qui confronte père et fils à la vérité de leur existence, qui fait exploser le malaise ressenti durant tout le film par le spectateur. Le film peut alors s'achever par un plan de Lee Kang Sheng surmontant sa douleur pour contempler l'immensité urbaine (là où Vive l'amour se terminait sur une fille en pleurs). En radicalisant l'approche des Rebelles du Dieu Néon, Tsai trouve le véritable trou d'air dans son cinéma. En se mettant au pied du mur, il trouve la voie vers un renouveau confirmé par la suite de sa filmographie où il aèrera fortement son dispositif.
Mal de vivre, quand tu nous tiens…
 Après un instantané de la jeunesse taiwanaise dans Vive l'Amour!, c’est à la cellule familiale et aux tabous récurrents de la société dans laquelle il vit que s’attaque Tsai Ming-Liang ici. En fil conducteur avec ses œuvres précédentes, Lee Kang-Sheng interprète un jeune garçon à la sexualité mal affirmée qui subit de plein fouet le malheur dissimulé de ses parents. La mise en scène prend toujours autant son temps, il y a toujours aussi peu de dialogues, toujours pas de musique, mais la force du film vient paradowalement de ces non-dits, de ces silences que le spectateur doit faire l’effort de décrypter sous peine d’être irrémédiablement mis à l’écart.
Après un instantané de la jeunesse taiwanaise dans Vive l'Amour!, c’est à la cellule familiale et aux tabous récurrents de la société dans laquelle il vit que s’attaque Tsai Ming-Liang ici. En fil conducteur avec ses œuvres précédentes, Lee Kang-Sheng interprète un jeune garçon à la sexualité mal affirmée qui subit de plein fouet le malheur dissimulé de ses parents. La mise en scène prend toujours autant son temps, il y a toujours aussi peu de dialogues, toujours pas de musique, mais la force du film vient paradowalement de ces non-dits, de ces silences que le spectateur doit faire l’effort de décrypter sous peine d’être irrémédiablement mis à l’écart.
Pour les 3 personnages, le mal-être est général : le père est un homosexuel inavoué qui fait chambre à part avec sa femme et passe le plus clair de son temps libre aux bains-douches où il vit de furtives rencontres câlines. La mère, rejetée, en manque d’affection, regarde des films érotiques avant de se frotter incestueusement à son fils. Symboliquement, 2 complications viennent noircir le tableau : le fils attrape tout d’abord un torticolis monstrueux dont il n’arrive pas à se défaire malgré le traitement de plusieurs spécialistes, et dont on ne sait s’il provient d’une saloperie contractée lorsqu’il jouait un rôle stupide de cadavre flottant dans une rivière pour un film d’Anne Hui ou s’il provient de sa nuit d’amour passée avec une amie de lycée (une punition "divine" parce qu'il risque de commettre les mêmes erreurs que son père?) ; ensuite, l’appartement habité par la famille est sujet à de multiples fuites provoquant des inondations à répétition – le délabrement des structures d’hébergement comme représentation d’un malaise indicible se retrouve notamment dans The Hole.
Si on lit en filigrane le propos de Tsai, on trouvera la dénonciation subtile d’une société n’acceptant pas l’homosexualité en tant que telle, et qui force indirectement la « normalité » d’un couple hétérosexuel. La Rivière démontre alors avec brio tous les malheurs que cela engendre, et ce pour l’ensemble d’une famille. La scène incestueuse finale chamboule subitement les habitudes silencieuses et pour la première fois, un tabou est brisé. Avec le dernier plan en totale opposition avec celui de Vive l’Amour, Tsai veut peut-être nous faire comprendre que c’est seulement en se parlant avec franchise, en communiquant sans peur de l’interdit que l’optimisme peut renaître. Une bien belle leçon à méditer, transmise avec douceur et avec un humour d’une finesse remarquable.