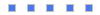Un film de car qui suit sa propre route
Qu’on ne vienne pas nous dire que Hiroshi Shimizu, ancien premier assistant de Takeshi Kitano, fait du Kitano. On peut toujours chercher dans Ikinai un sens du cadre appris chez le maître, ou une scène de groupe sur une plage, mais combien de films, finalement, ont une scène de groupe sur une plage. Non, rien d’intéressant à chercher là : Hiroshi Shimizu s’est imposé dès son premier film comme un auteur qui ne doit rien à personne, ou un peu à tout le monde. Ikinai sonne presque comme un manifeste d’indépendance, tellement ce premier film est mal luné, parfois mal foutu, mal dans sa peau et mal dans les cases traditionnelles : comédie amère ? Drame faussement gai ? Conte pas pour les enfants ? Seule définition simple, Ikinai est un « film de car », un vrai genre très fécond. Il mélange le film choral et le road movie, permet de s’arrêter pour faire un portrait de groupe, tout en avançant sur une route, plus aléatoire que celle du « film de train » (genre aussi fécond).
Ikinai s’intéresse tellement au groupe en tant que tel qu’il méprise ouvertement les individualités, à part celle de la jeune femme, qui justement n’est pas dans le groupe. Comme se groupe est lié par une volonté de suicide, Ikinai forme avec Distance et Kairo une trilogie morbide sur la tentation sectaire et suicidaire du Japon. Cette obsession du groupe exclue le « moi, je, qui », cette question résumée par Tima dans Metropolis et que se pose aussi le leader de la « secte » Ikinai : « Qu’est ce que ça veut dire : exister ? ». Le plus culotté dans Ikinai, c’est qu’il essaie d’être léger et drôle. Il y réussit parfois, même s’il faut goûter un peu à l’absurde pour rigoler des tronches d’enterrement qu’arborent ces candidats au grand saut. Parfois, il est vraiment trop abscons dans son humour-pas-drôle. On apprécie pas beaucoup, non plus, la fin très noire alors que dans les dernières minutes, le film entrevoyait la lumière.
Mais il vaut mieux retenir des moments étonnants (tout d’un coup, un corps tombe du haut de l’écran pour s’écraser au sol, comme dans Kairo, ces Japonais sont vraiment imprévisibles) et le son du film, limité à quelques bruits, comme si autour de ce groupe la vie s’était mise en sourdine. Hiroshi Shimizu introduit avec audace du théâtre, du drame antique et hiératique dans son road-movie. Tout le film est d’ailleurs paradoxal, c’est un peu la mort en chantant. Le plus terrible des paradoxes est de faire l’acte le plus intime qui soit (choisir sa mort) pour des raisons sociales, d’en revenir à l’individu (sa vie, sa mort) en ne parlant que du groupe et, hors champ, comme un monstre à fuir, de la société. Enfin puis si d’aventure vous étiez en pleine méthode Assimil du japonais, sachez que le film contient trois séquences ou le groupe fait un jeu de langage, ce qui nous apprend pleins de mots avec la traduction en dessous.
un premier film inégal mais plein de promesses
Après Kurosawa et avant Shindo Kaneto, voilà un ancien assistant-réalisateur de Kitano qui s'amuse à conjuguer le verbe vivre le temps d'un premier long métrage qui, s'il est inégal, révèle un vrai tempérament de cinéaste.
Comme pour beaucoup de premiers films d'auteurs japonais, la grande qualité d'Ikinai est son scénario qu'on pourrait découper en trois parties: exposition et découverte de notre bande de joyeux lurons suicidaires, pitreries à l'hotel et enfin final tragique. Sauf que la réussite des trois parties n'est pas la meme. L'exposition en particulier est assez ennuyeuse, manque de vraie tension et les gags qui y sont présents font plus rire que sourire. La seconde partie, si elle ne fait pas toujours dans la dentelle loin de là (cf un des personnages qui se met à jouer les exhibitionnistes afin de faire rire la gallerie), est malgré tout hilarante du fait de sa gallerie de personnages enfin développés avec le jeune homme qui veut gouter la cuisine française avant de mourir, l'homme d'affaires avec son portable toujours allumé, la jeune fille lourdingue accro au karaoké, le gros beauf qui n'arrete pas d'arborer des grimaces kitaniennes et l'amoureux déçu, ceux qui ont vécu de plein fouet la fin du miracle économique japonais des années 80. S'y dessine une gallerie de frustrés de la société japonaise bien décidés à se permettre tout et surtout n'importe quoi (les scènes dans la boite de strip tease, la lecture des lignes de la main par un charlatan qui prédit sans savoir que l'année de ses prédictions est passée) avant de mourir. Le grand mérite de cette partie est de recourir à des croquis de situation -une situation est ébauchée mais est coupée net par le montage avant de se développer- et ainsi de matérialiser de façon purement cinématographique le projet de caricature acerbe présent dans le scénario. La dernière partie, si elle est investie d'une vraie tension dramatique à cause de la rebellion ouverte du personnage féminin, manque néanmoins un peu de rythme et surtout s'achève de façon trop abrupte. Mais venons-en à la mise en scène. Certes, Shimizu a un vrai sens du cadre (les cadrages "à hauteur d'autobus" de nombreuses scènes) et le montage de la seconde partie du film est intéréssant par ses ellipses mais le reste du temps, la mise en scène fait un peu service minimum du cinéma d'auteur japonais avec ses plans fixes distants qui ne trouvent pas toujours leur bonne durée entrecoupés de quelques rares et banals mouvements de caméra en grue, bref, il n'y a pas hormis dans la seconde partie de manière originale. La mise en scène de Shimizu est bien plus intéréssante lorsqu'elle essaie de rendre compte du vertige de la chute d'un suicidé par des angles de vue audacieux.
En traitant sur un ton le plus souvent léger un thème souvent synonyme de noirceur dans le cinéma d'auteur japonais (cf Distance et sa vision désabusée du suicide collectif), Shimizu a réussi un premier film qui ne doit rien à son mentor Kitano. Reste pour lui à corriger les défauts scénaristiques et de mise en scène présents ici afin de pouvoir incarner la relève d'un cinéma d'auteur japonais sonné par la chute de la société de production de Sento Takenori.