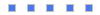Soleil Couchant
 Alors qu’Oshima a déjà décroché un succès public avec Contes cruels de la jeunesse, il continue malgré tout à tourner au rythme d’un film tous les trois mois. L’Enterrement du Soleil aura un réel impact sur la jeunesse japonaise de l’époque et son succès public le confirmera comme « sauveur » provisoire de la Shochiku. La voie est ainsi ouverte pour d’autres cinéastes de la Nouvelle Vague Shochiku.
Alors qu’Oshima a déjà décroché un succès public avec Contes cruels de la jeunesse, il continue malgré tout à tourner au rythme d’un film tous les trois mois. L’Enterrement du Soleil aura un réel impact sur la jeunesse japonaise de l’époque et son succès public le confirmera comme « sauveur » provisoire de la Shochiku. La voie est ainsi ouverte pour d’autres cinéastes de la Nouvelle Vague Shochiku.
Formellement, le film semble relativement plus «posé» que son précédent mais il comporte malgré tout son lot d’audaces. Les ruptures rythmiques, les trous narratifs sont moins présents et la mise en scène comme le montage laissent plus de place à une durée pesante et à un style moins heurté. Mais certains passages filmant de courts instants des quotidien du bidonville créent de la rupture rythmique tout en brouillant la frontière fiction/documentaire. Et les plans du ciel comme de l’horizon urbain au loin n’offrent aucun espoir, aucun échappatoire aux personnages. A l’image d’un titre de film voulant définitivement régler son compte à l’expression « pays du soleil levant ». L’utilisation d’un score aux sonorités souvent hispanisantes est ici autant un hommage au Bunuel peintre de la pauvreté de Los Olividados (admiré par Oshima) qu’un élément créant un contraste d’une grande portée politique. Ce score agréable à l’oreille « habille » cet univers des bidonvilles de Kamasaki (aux portes d’Osaka) un peu comme l’apparence du décollage économique japonais masque un Japon où «les hommes montrent les crocs et se battent comme des loups». On le voit notamment lors d’un meurtre filmé à distance sur fond de score de ce type ou lors de gros plans de visage dont la tristesse contraste avec le score du film. Rock’n’roll et mambo peuvent parfois créer une sensation identique tout en donnant a posteriori au film son parfum d’époque.
Le Japon du film, c’est l’autre Japon, celui laissé sur le bas coté de la route. Et cet univers fait de lumpenprolétariat, de petites frappes, ces grands décors en ruine ne sont pas sans évoquer le néoréalisme italien comme le Pasolini des débuts. S’occupant d’un poste médical clandestin où les pauvres peuvent s’acheter vêtements et nourritures en échange de sang, l’héroïne Hanako incarne une femme en forme de pure figure de survie. Survie étant à prendre ici dans son acception minimale : pas de dimension d’énergie vitale comme ça sera le cas chez les héros d’Imamura et Fukasaku mais une forme de fatalisme, de dimension froide et amorale, de distance froide permettant de vivre encore. Et puis ces voyous cyniques, prêts à subsister au mépris des vies humaines et du respect de l’autre. A l’opposé, on a son père dirigeant des voleurs, regrettant le passé du Japon, rêvant de la remilitarisation du pays. Le bidonville devient ainsi lieu où l’on «rejoue» parfois les lois de l’économie de marché en parlant partages et profits. Mais dans un économie de subsistance et non d’abondance. Et l’obsession de la Guerre Froide apparaît parfois au détour d’un dialogue. Il est notable que l’espoir de changement politique incarné à l’époque par l’extrême gauche soit complètement absent du film, comme si Oshima affichait son scepticisme face à une gauche organisée. Et il y a cette fin où rejouer l’histoire du Japon aboutit à un incendie et à une fin ironique : les personnages crient qu’ils ont rejoué le Japon sous les bombes et qu’il est maintenant à reconstruire alors qu’ils sont dans la réalité les laissés pour compte de cette reconstruction. Ni romantisation ni diabolisation des personnages ici, aucun optimisme factice ou mise des errements moraux des personnages sur le compte de la société comme dans beaucoup de «fictions de gauche». Le film contraste ainsi avec les taiyozokus dont il s’inspire comme avec un certain cinéma social japonais de l’époque.
Au final encore plus noir que Contes Cruels de la jeunesse, le film n’est néanmoins pas aussi abouti que ce dernier. Le propos est parfois lourdement asséné, le montage dilate parfois trop certains plans et surtout les personnages secondaires ne sont pas assez développés pour avoir un minimum d’intérêt : on tombe parfois dans le pur festival de «gueules». Ce qui n’empêche pas le film d’être un beau reflet de la créativité d’Oshima comme de la Nouvelle Vague de l’époque.
Jeunesse désabusée
Par son caractère crépusculaire et baigné d'inquiétude, L'enterrement du soleil est une des oeuvres pessimistes d'Oshima. La jeunesse qu'il dépeint est celle des bas quartiers, celle des "punks" d'époque, ceux qui rêvent d'être yakuzas mais qui n'en ont ni les épaules ni le charisme. A ce petit jeu, deux amis vont faire les frais d'une déchirure totale. En marchant dans la rue tard le soir, ils vont tomber nez à nez avec des membres d'une confrérie underground et répondre de leur provocation par la violence. Plutôt bons bagarreurs, ces derniers vont intégrer leur groupe et leur nouvelle vie de gangsters de bas étage va débuter, sous le soleil caniculaire et plombant annonçant leur séparation. Véritable chant funèbre d'une jeunesse sans repère (ce volet clôt d'ailleurs la Trilogie de la jeunesse, voir dépêche du 17/07/07), L'enterrement du soleil est une critique sociale à la fois sur l'économie souterraine et le milieu du gangstérisme auto proclamé (sans l'envergure des grands yakuzas) sous fond d'amitié brisée.
Oshima démontre les limites mêmes du gangstérisme (vols, tapages) par une séquence hors champs d'un viol d'une jeune femme dont le petit ami s'est fait assassiner sur l'instant. On apprendra dans la presse que cette jeune femme s'est suicidée des suites du décès de son ami. L'acte jusque là banal d'une bande de crapules (pillage) prend alors une tournure disproportionnée (viol + meurtre + suicide) et ne manquera pas de causer des troubles au sein même de la bande. Si l'un se plait dans son nouveau rôle de crapule, l'autre remet en cause les méthodes du groupe jugées trop malsaines et à juste titre agrandira le faussé de l'amitié. Visuellement plutôt réussi et aux notes musicales latines (souvent employées chez Suzuki) sous influence, L'enterrement du soleil outre ses nombreuses longueurs, est un film complet, Oshima prenant le recul suffisant pour poser les bases même de sa peinture juvénile, et montre sous son regard le plus froid la destruction de deux êtres, qui dans un plan séquence éloigné sous un score décalé annonce la mort d'une jeunesse ambitieuse et bien propre sur elle.
Dodes Kaden, version brechtienne
Troisième effort de Nagisa Oshima, L'enterrement du soleil (1960) est aussi le dernier de la veine naturaliste de l'auteur, avant que Nuit et brouillard au Japon (1961) ne marque le début d'une recherche plus axée sur la forme (et un renouvellement constant des efforts d'Oshima en la matière, jusqu'au retour à la sérénité classique du Zen japonais avec Tabou). Il est amusant de comparer cet Enterrement du soleil avec ce qui se faisait à l'époque dans le cinéma japonais. Les tronches des laborieux zonards entre deux âges du film ne sont pas très éloignées de celles qu'on voit dans les Bas fonds ou Dodes Kaden de Kurosawa ; les plans de coupe "paysagers" de la civilsation industrielle prise au soleil couchant ne sont pas si différents d'Ozu. La nouvelle vague pointe cependant le bout du nez avec une utilisation pour le moins déconcertante de la bande son et surtout un montage pour le moins brutal et hâché. Quant au fond, et comme l'ont bien expliqué les critiques précédents, le film est assez besogneux, hésitant entre le didactisme politique et le lyrisme des amours de jeunesse mais procure des images fortes et neuves qui impriment sans conteste la mémoire, même des cinéphiles les plus blasés. L'agression des lycéens amoureux - et ses suites - comptent parmi les meilleures scènes d'Oshima.
Un autre conte cruel de la jeunesse
Troisième film d'Oshima pour le grand écran, il persiste dans la voie du "film pour jeunes". Fortement impressionné par le cinéma de Bunuel, il en reprend la musique, mais surtout la description réaliste des bidonvilles et de ses habitants.
A la limite du documentaire, il est incroyable de voir combien le Japon était toujours touché par les ravages de la guerre. Routes campagnardes, champs de ruines, terrains vagues et bicoques de fortune abritant des figures décharnées représentaient les bas-fonds du pays en voie de (lente) reconstruction.
Forcément, toute une génération était sacrifiée : celle née juste à la fin de la guerre. Sans grands espoirs et surtout sans richesse, les enfants manquaient de la présence suffisante de leurs parents (tentant tant bien que mal de survivre), mais surtout d'une ferme éducation. Sans école, ni encadrement suffisant, ils empruntent la voie de leurs aînés de survivre à tout prix. Trouvant combines, se regroupant en clans pour être plus forts et vivant de vols et de coups montés, ils ne connaissent forcément ni peur, ni reproche, n'ayant absolument rien à perdre.
OSHIMA réussit brillamment à capter tout ce désespoir par une gallérie de portraits de tronches incroyables, de coups fourrés et de méchanceté et cruauté les uns envers les autres sans pareille. Des scènes humainement quasi insupportables, tant l'individualisme prime sur toute notion d'espoir et de partage.
Au milieu donc des jeunes protagonistes, soit prêts à tout pour survivre, soit entraînées par la force des choses. En ressortent finalement deux êtres diamétralement opposés, dont une fille - charmeuse et prête à tout pour surnager (OSHIMA caractérise son état actuel en utilisant magnifiquement deux couleurs de rouge à ongles : rouge, quand elle est en veine; noire quand le malheur est proche !!!) et un garçon - entraîné malgré lui dans le maelström de violence. Dommage seulement que l'interprétation de ce dernier soit à ce point fade et insignifiant par rapport aux autres acteurs pour pleinement émouvoir.
OSHIMA entame une lente spirale infernale, où les destins de chaque protagoniste semblent scellé dès le départ. Son film finit même par une note profondément pessimiste, quand il soulève la question QUAND le Japon sera de nouveau un vrai empire unifié et propose en ultime solution...l'anarchie pour totu détruire et recommencer une nouvelle fois de zéro (sur un champ de terre brûlée, un personnage ramassant des débris s'exclame : "du boulot, du boulot !".
Malheureusement, OSHIMA ne maîtrise pas encore totalement son propos: il y a des carences scénaristiques certaines, des longueurs inutiles et des redondances. Il n'arrive à totalement gérer l'interprétation parfois approximative de ses protagonistes et élucide trop certains passages clés du film.
Il n'empêche, que les images hantent longuement la mémoire après avoir vu le film et que son propos se cristallise clairement au milieu du foutoir visuel (voulu).