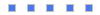


 Steven Spielberg n’est jamais aussi bon que quand il se contente de raconter une histoire, surtout quand cette histoire est adaptée du roman autobiographique de James Graham Ballard qui connut une jeunesse pour le moins difficile. Anglais né à Shanghai mais perpétuant la tradition victorienne par le biais de ses riches parents, James (Christian Bale) se retrouve en effet séparé d’eux par la force lors de l’invasion japonaise à la fin des années 30. Errant seul pendant plusieurs jours dans sa maison, il est recueilli par un homme étrange, mi-gentleman mi-truand (John Malkovich) avec qui il est conduit dans un camp de concentration près d’une base militaire nippone. Il y restera jusqu’en 1945 avant d’être libéré et de se retrouver à nouveau seul, marchant au hasard dans un monde chaotique et violent.
Steven Spielberg n’est jamais aussi bon que quand il se contente de raconter une histoire, surtout quand cette histoire est adaptée du roman autobiographique de James Graham Ballard qui connut une jeunesse pour le moins difficile. Anglais né à Shanghai mais perpétuant la tradition victorienne par le biais de ses riches parents, James (Christian Bale) se retrouve en effet séparé d’eux par la force lors de l’invasion japonaise à la fin des années 30. Errant seul pendant plusieurs jours dans sa maison, il est recueilli par un homme étrange, mi-gentleman mi-truand (John Malkovich) avec qui il est conduit dans un camp de concentration près d’une base militaire nippone. Il y restera jusqu’en 1945 avant d’être libéré et de se retrouver à nouveau seul, marchant au hasard dans un monde chaotique et violent.
 On comprend très bien ce qui a pu intéresser Spielberg dans ce récit : la guerre tout d’abord, qu’il relate aussi dans d’autres films comme 1941, Il faut sauver le soldat Ryan et La liste de Schindler. Mais ici, le point de vue est plus original car il s’agit de celui de civils occidentaux prisonniers dans un pays étranger, la Chine, occupé par un Empire qui a osé défier la toute-puissance américaine. Le second thème abordé ici est celui de l’enfance, un sujet qui lui est cher (E.T., A.I.) ; et là encore, ce thème s’avère plus surprenant qu’à l’accoutumée puisqu’il se transforme au fil des scènes en une stupéfiante description psychologique du délitement inexorable de l’âme de Jim. Joliment insinuée lorsque les pas de sa mère inscrits dans une poudre blanche s’effacent sous l’effet du vent, la perte de repères de ce gosse va s’enclencher et se développer de manière radicale dans le camp où il est prisonnier : tout d’abord fasciné par les avions de l’armée japonaise, il gagne petit à petit le respect de plusieurs hauts-gradés du camp ennemi en se montrant dévoué et intéressé, ce qui donne lieu à des scènes aussi belles qu’ambiguës lorsqu’il se tient par exemple au garde-à-vous devant une cérémonie de derniers sacrements pour des kamikazes. Perte de repères encore accentuée par l’oubli du visage de ses parents ainsi que par la bêtise dénoncée des adultes peuplant le camp, jusqu’à l’agonie spirituelle totale à la libération.
On comprend très bien ce qui a pu intéresser Spielberg dans ce récit : la guerre tout d’abord, qu’il relate aussi dans d’autres films comme 1941, Il faut sauver le soldat Ryan et La liste de Schindler. Mais ici, le point de vue est plus original car il s’agit de celui de civils occidentaux prisonniers dans un pays étranger, la Chine, occupé par un Empire qui a osé défier la toute-puissance américaine. Le second thème abordé ici est celui de l’enfance, un sujet qui lui est cher (E.T., A.I.) ; et là encore, ce thème s’avère plus surprenant qu’à l’accoutumée puisqu’il se transforme au fil des scènes en une stupéfiante description psychologique du délitement inexorable de l’âme de Jim. Joliment insinuée lorsque les pas de sa mère inscrits dans une poudre blanche s’effacent sous l’effet du vent, la perte de repères de ce gosse va s’enclencher et se développer de manière radicale dans le camp où il est prisonnier : tout d’abord fasciné par les avions de l’armée japonaise, il gagne petit à petit le respect de plusieurs hauts-gradés du camp ennemi en se montrant dévoué et intéressé, ce qui donne lieu à des scènes aussi belles qu’ambiguës lorsqu’il se tient par exemple au garde-à-vous devant une cérémonie de derniers sacrements pour des kamikazes. Perte de repères encore accentuée par l’oubli du visage de ses parents ainsi que par la bêtise dénoncée des adultes peuplant le camp, jusqu’à l’agonie spirituelle totale à la libération.
 Plus que tout, c’est la performance du jeune Christian Bale qui bouleverse jusqu’aux larmes. Malgré son courage et son espoir en des jours meilleurs (il apprend le latin et fait des statistiques sur le nombre d’insectes dans son riz), malgré sa vitalité qui lui a sans doute sauvé la vie, le fait de le voir détruit de l’intérieur lors du très émouvant épilogue touche au plus profond ; difficile d’oublier ses yeux hagards et son teint cadavérique semblant symboliser toute la détresse du monde en une seule et même personne. Autre point remarquable, la musique de John Williams n’est pas aussi pompière que d’habitude, sachant ménager de longues plages sonores muettes avant de faire décoller la dernière demi-heure avec des mélodies superbes. On y perd parfois en lyrisme, mais on y gagne en sobriété et en justesse. Quand à la mise en scène, elle est maîtrisée de bout en bout et sait se faire discrète pour le bien de l’intrigue. En clair, James Graham Ballard peut être fier de l’adaptation de son livre à l’écran ; à la fois fidèle et personnelle au réalisateur, elle peut être considérée comme un modèle du genre. Et grâce à ce film, on comprend maintenant mieux de quel cerveau malade provient ce roman dérangeant, déviant et sulfureux du nom de Crash (adapté au cinéma par Cronenberg), où des gens fatalistes aiment à baiser après des accidents de voiture…
Plus que tout, c’est la performance du jeune Christian Bale qui bouleverse jusqu’aux larmes. Malgré son courage et son espoir en des jours meilleurs (il apprend le latin et fait des statistiques sur le nombre d’insectes dans son riz), malgré sa vitalité qui lui a sans doute sauvé la vie, le fait de le voir détruit de l’intérieur lors du très émouvant épilogue touche au plus profond ; difficile d’oublier ses yeux hagards et son teint cadavérique semblant symboliser toute la détresse du monde en une seule et même personne. Autre point remarquable, la musique de John Williams n’est pas aussi pompière que d’habitude, sachant ménager de longues plages sonores muettes avant de faire décoller la dernière demi-heure avec des mélodies superbes. On y perd parfois en lyrisme, mais on y gagne en sobriété et en justesse. Quand à la mise en scène, elle est maîtrisée de bout en bout et sait se faire discrète pour le bien de l’intrigue. En clair, James Graham Ballard peut être fier de l’adaptation de son livre à l’écran ; à la fois fidèle et personnelle au réalisateur, elle peut être considérée comme un modèle du genre. Et grâce à ce film, on comprend maintenant mieux de quel cerveau malade provient ce roman dérangeant, déviant et sulfureux du nom de Crash (adapté au cinéma par Cronenberg), où des gens fatalistes aiment à baiser après des accidents de voiture…


