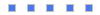


Bande annonce
On a reproché à l’œuvre d’Alejandro G. Iñarritu d’être bien trop focalisée sur un système de narration éclatée, impliquant plusieurs histoires différentes les unes avec les autres. Critiquée, démontée pour cause d’artifices et de style tout en lourdeur, comme si la critique bien pensante aimant fustiger les cinéastes qui en font beaucoup trop était détentrice de la bonne parole. Avec Babel, dernier volet d’une trilogie entamée avec Amours Chiennes, le cinéaste mexicain signe son œuvre somme, magistrale, démesurée pour nous, spectateurs trop habitués au conformisme ou immédiatement heurtés lorsque la grandeur est vue comme de l’esbroufe ou du tape à l’œil. Pardonnez les ambitions un peu trop grandes d’Iñarritu en allant voir ailleurs s’il y est, aux quatre coins du globe, de l’Amérique centrale en passant par le Maroc et le Japon, trois opposés géographiques et culturels en forme d’exemple légitime à la probabilité qu’une cause entraîne un effet, n’importe où dans le monde. Un petit rien de matière ou d’inconscient. Sans s’y soucier, l’air de rien. Iñarritu choisit le fusil comme objet de catastrophe et reflet d’une mondialisation qui a ses bons et mauvais côtés. Une vieille Winchester appartenant à un japonais, puis offerte à un marocain perdu dans les collines, offerte à un autre marocain pour être ensuite sous la responsabilité de deux gosses qui s’en serviront pour rigoler. Résultat, une touriste américaine gravement blessée, un accident repris par les journalistes comme une tentative de terrorisme (2005, on est encore dans le tourbillon post-11 septembre), et des réactions en chaîne pas du tout prévues qui détruiront une famille mexicaine. En effet, étant donné que le couple d’américains ne peut rentrer à temps, la nourrice qui s’occupe de leurs enfants se doit de les garder avec elle, qu’importe le mariage auquel elle doit assister. Il y a ici une absence de véritable prise de conscience qui entraînera, à cause de l’impossibilité du couple de rentrer, et donc à cause du tir du fusil, la rupture totale entre une nourrice mexicaine clandestine et la vie correcte qu’elle menait jusque-là. L’idée géniale d’Iñarritu est de poser à chaque épisode son récit dans un cadre géographique bien précis, tout en s’amusant avec les codes du temps, rappelant un peu ce que l’on faisait dans le nouveau cinéma espagnol des années 70 avec la rupture totale des normes et des codes depuis la mort de Franco.
Evidemment, le cinéaste n’est pas le premier à déboussoler le spectateur par sa maîtrise du temps. Babel a beau être prodigieux dans sa structure narrative et temporelle, il n’empêche qu’il n’est pas le seul, et la critique facile attaquera Iñarritu sur ce point. Pourtant, son récit déstructuré garde finalement une grande cohérence avec son sujet et ses ambitions thématiques : disposer de divers points de vue autour d’un même fait, d’un même accident, malgré les frontières géographiques et morales qui séparent les êtres humains. Pourquoi Tokyo, alors ? On s’en fiche, Iñarritu dit lui-même qu’il trouve quelque chose d’unique dans cette ville. Pourquoi les collines du Maroc, également ? En sortant du registre purement fictionnel, les terres arabes à cette époque sont des cibles parfaites pour les médias, à partir du moment où un touriste étranger se fait attaqué – on pense à l’Egypte notamment- et que cette attaque prenne des proportions immenses, toutes liées à la hâte au terrorisme. Et le Mexique, rien de plus normal lorsque l’on connait la situation difficile des mexicains qui passent la frontière tous les jours pour avoir à manger dans la marmite. Babel ne résoudra rien, il n’est pas un pamphlet, encore moins un brûlot, juste un grand film de fiction basé sur une réalité sociale. Pardonnez également à Iñarritu de faire son fond de commerce avec cette donne, sans doute qu’Hollywood, espoir dans l’humanité et mondialisation font un peu tache ensemble.
Pourtant, d’un point de vue de cinéma, Babel est un film prodigieux. Pas extraordinaire, non, on reste dans un certain réalisme, et si la frontière entre la réalité et le rêve –entraînant donc une part de « fantastique »- est allègrement franchie le temps d’un épisode tokyoïte sous acides, Babel est un film qui reste dans la normalité, sur le papier. Un tir, une conséquence, des histoires du monde. C’est tout simplement ça, Babel. Nul besoin d’avoir recours à des rebondissements surréalistes à la 24h Chrono, on est trop loin du système classique Hollywoodien grand public, le film d’Iñarritu ne cherche à aucun moment cette idée d’exceptionnel ou de sensationnalisme en ayant recours à toute forme d’aberrance pour faire coïncider un même bouleversement dans trois pays géographiquement opposés. Il est tellement évident, tellement coulant et cohérent qu’il se suffit à lui-même : c’est ainsi que le destin d’une nourrice mexicaine et d’une japonaise sourde et muette va être bouleversé par un simple coup de feu déclenché à des milliers de kilomètres.
Sans être obligé de passer par des éléments invraisemblables, le film coule de source et est, d’un point de vue fictionnel, passionnant. Il n’aurait en rien volé quelconque distinction pour sa qualité d’écriture, la cohérence de ses propos mais également pour ses portraits d’hommes et de femmes bouleversants. On pense à Amélia, prenant le risque d’assister à un mariage au Mexique avec les enfants du couple de touristes, fête qui virera au cauchemar et dont la présence des enfants est liée à l’absence des parents retenus au Maroc après le coup de feu. On pense aussi à Chieko, adolescente psychologiquement déviante qui semble être persuadée qu’elle trouvera une raison à son bonheur par des jeux déviants. Quel rapport avec l’accident au Maroc ? On l’apprendra durant le dernier tiers du film. Le cinéaste dit d’une Kikuchi Rinko qu’elle est l’une des rares actrices à l’avoir autant sidéré, de par son physique particulier et son étrange charisme. Il préfère se centrer sur ce personnage abandonné de son père et de la société, reflet du tourment un peu lourd de la jeunesse nippone mais délivrant des moments de cinéma d’une liberté proprement sidérante. Il suffit de voir comment Chieko et son amie se laissent aller à l’extasie dans les rues de Shibuya, pendant halluciné d’un Iwai Shunji pour le coup, de par son filmage et sa faculté à faire « sens » de manière légère et emportée, avant de tomber dans un trip sensoriel en boîte de nuit, magnifique de poésie triste et décharnée. Babel, grand film, terrasse par sa beauté et son approche dramatique du genre humain n’y apposant aucun point de vue nauséabond sur le monde. Iñarritu, contrairement aux boursouflés Haneke et Lars Von Trier, n’a pas besoin d’utiliser le médium cinéma pour cracher au visage d’une femme irresponsable, de gamins meurtriers ou d’une adolescente sexuellement déviante. Il y coule une profonde tristesse, non seulement par les cordes latines de Gustavo Santaolalla et les notes de piano inconsolables de Sakamoto Ryuichi, mais aussi par le fait que les conséquences d’un geste –un tir, une fuite en voiture- sont purement et simplement irréparables et graves de conséquences. Comme une impasse infranchissable malgré le fait que les zones soient ouvertes, presque interminables. Ou comment les hautes instances disposent du droit de vie ou de mort sur chaque population des quatre coins du globe. Cette tristesse est magnifiée par l’interprétation forte des interprètes principaux du film, du Maroc au Mexique, en passant par l’épisode insomniaque au Japon qui vaudra à Adriana Barraza et Kikuchi Rinko une reconnaissance internationale. Comme un tout marquant, Babel est une œuvre puissante résolument moderne qui n’a en rien volé son prix de la mise en scène à Cannes tant elle fait preuve d’une consistance et d’une cohérence fascinantes. Iñarritu capte aussi bien les moments suffocants que l’ivresse de la vie humaine(le mariage au Mexique, les virées urbaines au Japon) avec une poésie elle aussi, tout à fait moderne. Celle de provoquer les larmes et les cris par son épaisse poussière et aridité. Du très grand cinéma.
 Dans un style toujours aussi plaisant à suivre pour qui apprécie Inarritu et ses imbrications de plusieurs histoires les unes dans les autres faisant ressortir un tout cohérent, Babel est une illustration relativement pertinente de cette mondialisation dont on parle tant et qui brasse les cultures, les produits et les hommes d'une manière inextricable et sous-estimée. Ainsi, californiens blonds comme les blés, mexicains, marocains ruraux et japonais urbains sont reliés entre eux sans forcément le savoir, pour le meilleur comme pour le pire. D'ailleurs un peu trop pour le pire, et c'est sans doute le principal reproche que l'on peut faire à Inarritu : il n'est ici question que de flingues qui s'échangent à travers les continents et qui sèment la violence, de suicide, de soupçons de terrorisme, de clandestins, de courses-poursuites avec des flics pointilleux, d'abandon d'enfants dans la pampa par 40° au soleil, ou encore d'une jeunesse paumée en mal d'affection...
Dans un style toujours aussi plaisant à suivre pour qui apprécie Inarritu et ses imbrications de plusieurs histoires les unes dans les autres faisant ressortir un tout cohérent, Babel est une illustration relativement pertinente de cette mondialisation dont on parle tant et qui brasse les cultures, les produits et les hommes d'une manière inextricable et sous-estimée. Ainsi, californiens blonds comme les blés, mexicains, marocains ruraux et japonais urbains sont reliés entre eux sans forcément le savoir, pour le meilleur comme pour le pire. D'ailleurs un peu trop pour le pire, et c'est sans doute le principal reproche que l'on peut faire à Inarritu : il n'est ici question que de flingues qui s'échangent à travers les continents et qui sèment la violence, de suicide, de soupçons de terrorisme, de clandestins, de courses-poursuites avec des flics pointilleux, d'abandon d'enfants dans la pampa par 40° au soleil, ou encore d'une jeunesse paumée en mal d'affection...
Où donc Inarritu veut-il en venir? En signant cette nouvelle fresque humaine contemporaine, et malgré un talent indéniable pour poser un cadre, décrire des personnages attanchants et emballer le tout visuellement et musicalement, il n'évite pas la caricature et les clichés. N'y a-t-il donc pas de mondialisation heureuse?


