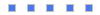
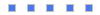

| Yann K | 2 | Vacance (de cinéaste) en Thailande |
| Xavier Chanoine | 3.5 | Moins bouleversant que ses précédents, mais de sacrées fulgurances |
Après une série de succès artistiques, deux compétitions à Cannes, la gamelle. Nanayo n'a été pris dans aucun festival majeur et a fait l'ouverture du festival de... Bangkok, le film ayant été tourné en Thailande. Un four. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, non, j'ai ainsi vu ce film avant Cannes 2008. Il est alors sorti juste au Japon, et a déjà un air de "bon on en parle plus, next". Il mérite tout de même d'être projeté à un moment en France, pour Kawase, pour Grégoire Colin, pour mémoire. Pas trop pour le film en soi. Il a plusieurs gros problèmes qui rappellent à chaque fois de grands enseignements du cinema. On assiste, assez médusé, à un film d'étudiant amateur qui a ses pelletées de maladresses. C'est pas nul, non, on serait content si c'était de notre cousin de 25 ans, mais venant de Naomi Kawase, ça fait mal.
Le premier souci est un panneau dans lequel tombe nombre de cinéastes filmant à l'étranger et ne parlant pas la langue d'un des acteurs. "Attention, vanité", ça dit. Paf : Grégoire Colin est nul une bonne partie du film, ce qui plombe un bon tiers. Naomi Kawase n'a pas réussi le miracle de son compatriote Nobohiro Suwa dans Un couple Parfait, ou de Hou Hsiao-Hsien pour Le Ballon Rouge, qui ont réussi à faire tourner avec un naturel confondant des acteurs dont ils ne parlaient pas du tout la langue.
Mais peut être est-ce aussi une question de clarté du message envoyé aux acteurs. Car Grégoire Colin a bien moins de texte que Bruno Todeschini chez Suwa, la majorité de son rôle est silencieux, et la partie en anglais de cuisine passe pas si mal, avec les charmantes approximations. Car le vrai souci est un scénario très bâclé, qui ne regarde les personnages qu'en surface et raconte en pointillés. Le trouble, l'hésitation, ça ne tient pas deux heures. Les acteurs semblent ici souvent juste perdus. Leur alchimie ne prend pas réellement. L'actrice japonaise s'en sort mieux, assez logiquement, mais sur un mode minimaliste, principalement parce qu'elle se sent plus à l'aise.
L'incapacité à "se laisser aller", voilà le sujet du film, déjà au coeur de La forêt de Mogari. Mais là où ce dernier offrait une scène cathartique inouïe au bord d'une cascade, puis une autre ultra sensuelle au pied d'un arbre, ici Kawase tente plus basiquement des scènes de cul. Dans une maison au coeur de la forêt thailandaise sous la chaleur humide, à la lumière des bougies. Le panneau était là aussi, mais Kawase ne l'a pas plus vu : "La plage". "Bilitis". Vous imaginez? C'est beau, hmmh, c'est chaud, hmmh, torride, hmmmh, remets moi du Tahiti Douche, prend un Hollywood Chewing gum, quelle fraicheur de vivre. "Se laisser aller", donc. Quand toute une équipe s'y met, elle fait de la soupe world pub.
Tous les petits défauts de Naomi Kawase sont ici accentués : naïveté, confusion, image pour l'image. Peut être enfin parce que le dernier défaut du film est d'être auto-produit, comme Shara. La réalisatrice pensait alors surement retrouver la même énergie créatrice, mais Shara était une ligne claire, ténue, miraculeuse de bout en bout, alors que celui-ci est une ligne constamment brisée.
Tout n'est pas perdu : le film a de beaux moments, comme le début à Bangkok, avant l'arrivée de Grégoire Colin, ça et là des plans sidérants, et surtout un travail sonore d'une grande volupté. Il donne souvent envie d'aller en Thailande tellement c'est agréable. La dernier plan, une caméra qui se balance doucement au milieu de la forêt, au gré d'une barque, est somptueux en soi. Mais à la fin de ce film, malheureusement, il donne l'impression d'être posé là comme ailleurs, exprimant une valse hésitation, la confusion de la réalisatrice, transmise au spectateur.
Bande annonce
Depuis ses débuts à la vidéo, la réalisatrice Kawase Naomi a apporté au cinéma ce qu’il fallait de grâce, de légèreté et de mysticisme pour que le cinéma fasse encore rêver. Au diable donc le cinéma se définissant uniquement par la puissance des acteurs ou par la solidité d’une intrigue à tiroirs. Depuis l’émergence du cinéma d’auteur asiatique, bon nombre de cinéastes se sont essayés à la démarche de réaliser des films différents, comprenons par là sans grands acteurs connus, sans intrigue particulière, avec la revendication totale de faire du cinéma de chronique pour la chronique : filmer des personnes, filmer une ruelle bien éclairée par le chef opérateur, filmer un quotidien tendre ou désespérant. Mieux vaut se tourner vers la Chine continentale pour ce dernier exemple. Kawase Naomi se démarque de ces auteurs de la chronique pour la chronique, et même si le cinéma de cette dernière trouve une vraie définition dans l’exploitation de la nature à des fins poétiques (depuis Katasumori en 1994 jusqu’à La Forêt de Mogari 13 ans plus tard), la confrontation naturel/surnaturel la rapproche d’un cinéaste comme Apichatpong Weerasethakul, autre grand cinéaste inspiré lorsqu’il filme le vide, la nature, le mouvement. Et cela tombe parfaitement, Kawase Naomi pose son « intrigue » en Thaïlande, variant les niveaux d’ambiance comme pour mieux confronter l’énergie des marchés à la douceur zen des temples en pleine jungle. On retrouve une expatriée japonaise, Saiko, fraichement arrivée en Thaïlande dans le but de reconstruire une nouvelle vie après un épisode au Japon visiblement désagréable. A peine le temps de découvrir les lieux et de communiquer dans un anglais approximatif avec la population locale, la voilà embarquée dans un taxi où l’absence de communication entraîne de sérieux problèmes : se croyant attaquée après que le taxi se soit arrêté en pleine jungle, Saiko s’enfuit en laissant bagages et biens dans le coffre, tente de repousser le chauffeur de taxi qui ne semble pourtant pas lui vouloir beaucoup de mal. A la fin de son échappée, elle découvre un repère tenu par une masseuse professionnelle et son ami français. Greg, le français, la rassure et lui trouve en toute logique une place au sein de l’établissement. Accueillie et rassurée par ce dernier, le chauffeur de taxi débarque à son tour. Chacun va cohabiter à cet endroit, des liens vont se tisser, se détruire…


Le plus intéressant dans cette entreprise foutraque est que personne ne peut communiquer autrement que par les gestes –de massage en partie, ce qui donne lieu à des instants de tendresse et de franche rigolade tout au long du film. Si l’on rigole de la prononciation du mot « pluie », très délicate pour Saiko et que l’on trinque dans toutes les langues –thaïlandais, japonais, français et anglais, très vite le climat prend une toute autre tournure : une attaque subite dans un marché de nuit, virant de la peur au sentiment d’euphorie une fois les malfrats semés, rapprochera les hôtes, déliera les langues malgré une communication très souvent à sens unique. L’art de la cinéaste est d’ailleurs de convertir ces échanges en instant de grâce et d’émotion pure. Si ce pari est une fois de plus réussi, démontrant le savoir-faire de la cinéaste pour filmer le naturel et le trouble avec un sens inouïe, force est de constater le côté quelque peu vain du film dans son ensemble. Remarqué car possédant dans sa besace ça et là quelques séquences extraordinaires (les plans rapprochés sur Hasegawa Kyoko, la fuite dans le marché de nuit, la séquence d’hystérie suite à la disparition du petit d’Amari, la patronne des lieux) qui remplissent une intrigue trop molle et sans grand but si ce n’est d’étaler des tics de mise-en-scène et d’appuyer un style qui a fait ses marques depuis Suzaku. Que du bon dirait-on, mais avec du recul, cette méthode empêche Kawase Naomi d’évoluer plus encore. Le recyclage va jusque dans une danse de fin, magnifique mais incapable de nous faire oublier celle de Shara. Les discussions entre les protagonistes pourront ennuyer le spectateur le moins sensible, la faute à une interprétation trop inégale de la part de Grégoire Colin et une dernière partie s’axant bien trop sur l’avenir du petit (sera-t-il moine comme le souhaite sa mère ?), agrémentée d’une couche épaisse de rêves qui font tout sauf sens.


C’est juste très joli, cadré avec magie. Qu’importe qui signe la photo, c’est du Kawase en –beau pilotage automatique, jusque dans les éternels plans sur une flore bel et bien vivante. On aura néanmoins vu plus intense dernièrement avec La Forêt de Mogari et ses arbres qui gémissent, même si la direction du son orchestrée par Akritchalerm Kalayanamitr (Syndromes and a Century, Vagues invisibles, Ploy…) est une fois de plus enivrante. Reste que si Kawase avait jusque là l’habitude de rendre hommage au troisième âge (de ses documentaires et court-métrages personnels jusqu’à son dernier film), ici c’est l’enfance qui est mise au premier plan : d’abord la thématique de la naissance/renaissance avec la nouvelle vie de Saiko, et ensuite la question de l’avenir du petit, suscitant de vives discussions au sujet de l’importance de la religion en société pour des gamins de dix ans. Doivent-ils être embarqués dans la religion très tôt, est-ce un frein à leur épanouissement ? Des questions qui trouveront des réponses en surface, mais rien de réellement pertinent, tout juste est-ce là un prétexte à une séquence d’hystérie sidérante lorsque le petit est porté disparu depuis que ces questions ont été abordées par sa mère. Il manque donc quelque chose à Nanayo pour être un grand Kawase, car si le travail visuel et sensoriel est toujours aussi juste, et les fulgurances toujours présentes au bon moment, la sensation d’avoir affaire à un film sans grand but nous amène à penser que la cinéaste n’est pas encore prête à prendre des risques. Beau, souvent touchant, un peu vain sans doute.







