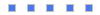

| Arno Ching-wan | 4.75  |
Ballet de regards de l'Est |
| Ordell Robbie | 5  |
Loups Solitaires |
| Xavier Chanoine | 4 | Grande réussite d'un cinéaste alors en état de grâce |

Je les ai enfin découverts, ces Loups, dont le titre original veut dire « Cérémonie de sortie de prison » me précise le livret disponible dans le BR. Cela tombe plutôt bien parce que la première chose qui m'a frappé, c'est cela, la porte d'une prison, lors de la libération anticipée des protagonistes. Vlan ! Me voilà balafré tout comme eux ! A l'aide d'un formidable effet de montage qui fait se mélanger cette sortie (arrêt image sur chaque personnage), l'avant (la boucherie originelle) puis l'après (l'amour avec une femme) on pense à la célèbre introduction du Guet-apens de Sam Peckinpah qui lui suivra l'année suivante, en 1972. La conclusion, elle, anticipe de plus de 40 ans celle du récent Hacker de Michael Mann, un tout aussi brillant formaliste qui recherchera également le morceau de bravoure au milieu d'une parade au rouge chatoyant. Dans Les loups, la scène du tambour y est à mes sens vouée à rester dans les annales, et il n'y a certainement pas prescription tant cette péloche garde encore sa toute puissance. Entre ces deux échos occidentaux, on baigne à 200% dans le Japon d'alors. Si l'on commence avec deux brefs plans penchés à la Kinji Fukasaku, très vite on glisse et l'on bascule chez Hideo Gosha. On apprécie sa pleine forme, son fétichisme, son style. Terrain connu.


Le réalisateur est ici au sommet de son art, tout en haut du Mont Fuji. Son génie graphique est cimenté par une histoire chargée de résonances, une trame faussement classique transcendée par une trahison amenée de façon redoutable. Le point de vue est pleinement ressenti, empathique. Un monde s'écroule. Des personnages forts et une inspiration prégnante de l'instant nourrissent également une oeuvre dont la poésie, souvent macabre, est de nombreuses fois convoquée. Des tueurs et victimes passent leurs derniers temps, bonus vain d'existence, à baiser avec la mort, cette salope de femme. Les corps se mélangent, les tatouages se jouxtent, les membres pénètrent autant que les couteaux. On est chez Gosha alors on ne donne pas la vie, on la prend ! Ces condamnés sont sortis de prison trop tôt, ils doivent mourir tout comme un bébé prématuré arriverait dans le monde sans être suffisamment armé pour l'affronter. Dès lors, baisons mais sans procréer, surtout pas ! Car on sent que dans cet univers la cruauté consisterait davantage à invoquer une nouvelle âme plutôt que d'en renvoyer une dans un ailleurs forcément préférable. Aussi se cache-t-on dans une petite forêt pour un plan à trois qui dure, qui dure, avec comme ultime jouissance la mort. Pas la petite : la grande, la violente, la jouissive ! Longuement étranglé et plusieurs fois poignardé, au pauvre ère de succomber devant une caméra triste que le calvaire se termine déjà. Car libéré est cet homme, pas le cinéaste et encore moins le spectateur. Tout est de cet acabit pendant deux heures. Lorsque les tantōs ne tranchent pas, ce sont aux regards de se chercher, de fuir, d'esquiver, de contrer. Rien n'est laissé au hasard, le mouvement des pupilles est chorégraphié autant que celui des mentons, cous, épaules, lèvres... et la caméra s'adapte sur un ensemble millimétré à la folie. Voilà du masochisme beau à en crever, un monde où hommes et femmes, pour continuer à y vivre un peu – on passe dans la douleur de l'ère de Taisho à celle de Showa - s'en mettent plein la tronche dans un ultime baroud d'honneur. Déjà vu, oui, mais aussi bien franchement ? La horde sauvage ? Peckinpah ! Malgré la pleine réussite artistique, le film se planta au Box Office. Sans doute en réaction à cet échec commercial, Gosha développera ensuite une brève idée de film, la métaphore du combat de coqs, dans l'à peine moins dément Quartier violent. Il y glissera une bonne partie du casting, enlèvera le torturé Nakadai au profit du plus populaire Bunta Sugawara pour se moquer du tout comme un Paul Verhoeven avant l'heure. Et l'on y sourira, cynique, comme à la fin de La Croix de fer. Peckinpah, encore et toujours. De l'évolution magistralement cohérente d'une filmographie épatante et fraternelle en cela qu'elle suivit, un temps, un chemin parallèle à un autre génie tout autant mélancolique. Cette maladie du cinéphile.

Avant d'évoquer un des chefs d'oeuvre de Gosha Hideo, peut être un des films qui par sa durée, son ampleur et sa densité thématique pourrait être qualifié de fresque mafieuse, un petit détour au rayon lexique des genres du cinéma nippon: les ninkyo eiga, ou films de chevalerie, étaient des films de yakuza se situant avant-guerre et exprimant des valeurs traditionnelles portées par des gangsters en forme de figures héroiques et d'hommes d'honneur. Ces films qui connurent leur âge d'or durant les années 60 ont souvent comme trame le conflit entre le giri et le ninjo, entre la fidélité au clan et les sentiments personnels et obéissaient à une formule systématique.
Sauf que ce sont les cinéastes qui mirent fin à son règne qui sont bien plus connus en Occident: si Suzuki fit des ninkyo eigas (le Vagabond de Kanto, la Vie d'un Tatoué) il imprima vite au yakuza eiga sa patte surréaliste et stylisée loin des questions de code d'honneur; mais c'est surtout Fukasaku qui signa l'arrêt de mort du genre avec la série démythificatrice des Combat sans Code d'Honneur. Néanmoins, la formule du genre put auparavant être transcendée par Kato Tai et Gosha. Ce qui nous ramène aux Loups. Qui pose son sujet de façon virtuose dans un cinéma: deux clans tentent de négocier sur la question d'un chemin de fer en construction, question de territoires, quand ils apprennent qu'un autre clan l'a fait exploser. Plus loin, le film fait son petit rappel historique sur l'ère Showa -dont l'instabilité politique et sociale précède l'arrivée d'Hiro Hito- en croisant avec talent titres de journaux et extraits d'actualité d'époque, présente ses personnages sortis de prison grâce à une amnistie à coup de zooms et d'arrêts sur image. Et en faisant naître la violence dans l'obscurité d'une salle de cinéma, Gosha annonce les grands motifs du film, la nuit d'une oeuvre baignant le plus souvent dans une photographie jouant sur les ombres et l'idée de lieux clos, lieux où se réglent la plupart du temps dans le film par la parole (le film est très bavard mais ce qu'il dit est toujours essentiel à la progression du récit, les longues discussions n'ont pas ce rôle digressif souvent vu chez les cinéastes américains classiques) ou parfois l'arme blanche les questions de pouvoir, d'honneur, de rivalités entre les clans. Bref le décor est posé vite et bien, permettant à celui qui ignore les enjeux politiques de l'époque (et l'histoire du Japon, Gosha a au moins le mérite de penser qu'il existe sur terres des gens qui voudraient apprécier les qualités de son oeuvre sans etre obligé de s'y replonger, ce n'est pas le cas d'un HHH dont le beau City of Sadness nécessite de relire son histoire de Taïwan si on veut éviter de rester sur le carreau...) de pouvoir s'y retrouver par la suite (le genre de choses qui feront que les générations futures pourront revoir dans 20 ans le Scarface de De Palma sans mettre le nez dans les bouquins d'histoire).
Fresque mafieuse, les Loups l'est bien sur par son ampleur rythmique et son souffle classique de mise en scène mais aussi par l'ingrédient indispensable à tout grand film du genre, l'ancrage fort dans un contexte historique et politique précis: comme dans tout un pan du western le chemin de fer est au centre du récit parce qu'il renvoie à l'histoire d'une nation, l'esprit pionnier chez les Américains et ici la volonté d'expansion territoriale du Japon notamment vers la Mandchourie qui deviendra tristement célèbre pour les atrocités qui y furent perpétrées par l'armée japonaise durant la Seconde Guerre Mondiale -cf la Condition de l'Homme-; en montrant cette volonté-là comme nourrie par l'ambition des clans de yakuzas (dont on connait les liens encore vivaces aujourd'hui avec l'extrême-droite nipponne) ayant bénéficié de clémence politique (la loi d'amnistie) et profitant de la misère et du chaos ambiant (le tremblement de terre de Kanto) Gosha fait bien évidemment oeuvre de dénonciation virulente, la révolte de ses personnages contre leur propre clan (figure classique de son cinéma) et ses lois (les codes d'honneur instrumentalisés dans un but de pouvoir au mépris de l'humain -les anciens membres de clan devenus persona non grata, les mariages arrangés-) prend une dimension politique. Révolte vaine parce qu'elle ramène Nakadai à la case départ (la prison) à la fin et qu'elle ne peut empecher l'histoire de poursuivre le cours que l'on sait, chose que nous rappellent les allusions historiques des derniers instants du film. Nakadai qui trouve d'ailleurs ici un de ses plus beaux rôles (selon moi en tout cas, certains nippocinéphiles le trouvent moins convaincant dans ce genre de roles que Tsuruta Koji), de figure solitaire écartelée entre les codes d'honneur et le respect du clan qu'ils imposent et ses propres sentiments humains voire humanistes -tendresse pour une femme aussi solitaire que lui rencontrée près du rivage, fidélité à un ami-, une figure archétypale du genre (et symbole d'un des éléments clés de la culture japonaise: le conflit entre les contraintes collectives extremement strictes de la société japonaise et les aspiration individuelles de ceux qui les subissent) que son interprétation transcende. Et il y a bien sur le sens de la création de la durée d'un Gosha offrant de beaux moments contemplatifs -les scènes de rivage magnifiques, Goyokin avait d'ailleurs prouvé que Gosha excellait dans ces scènes-là-, offrant un montage assez lent de duels à l'arme blanche parfois rendus plus intenses par l'obscurité créatrice de suspens sur leur issue, quelques usages pertinents du zoom et un vrai sens du cadre habituel chez le cinéaste. Le score de Sato Masaru réussit lui à combiner vrai souffle classique et un type d'orchestration proche du versant plus jazzy de sa collaboration avec Kurosawa.
Honneur, fidélité, amitiés, commentaire social, presque tout ce que l'on peut aimer au rayon film de gangsters de trouve dans les Loups. Mais un film de gangsters où l'on dégainerait l'arme blanche -comme le veulent les codes du ninkyo, où l'usage des armes à feu est sporadique- plutot que le revolver. Une belle introduction au ninkyo eiga et un sommet du cinéma de genre nippon seventies.
L'un des meilleurs Gosha est aussi l'un des plus rares. Toujours pas sur les cahiers des sorties d'éditeurs qui ont jusque là bien ratissés son univers, sûrement dû à un problème de droit (l'un des rares films de Gosha produit et distribué par la Toho), Les Loups s'inscrit pourtant dans sa veine la plus rare mais aussi la plus passionnante. Gosha n'est pas qu'un réalisateur de jidaigeki et même si Les Loups est un film en costumes, il appartient au genre yakuza eiga dépeint par un cinéaste qui a déjà donné avec le coup d'essai réussi Le Sand du Damné et qui donnera plus tard avec le nerveux Quartier Violent à mon sens moins réussi car plus mainstream dans son déroulement. Qu'est ce qui fait que l'on trouve ces loups plus terrifiants? Sans doute parce que le cercle de gangsters est ici dépeint avec un réalisme remarquable, Gosha extrait de ces salauds une forme de compassion ou d'attachement pour le spectateur qui se trouve alors plongé dans cet univers sombre et en pleine mutation simplement par la force des images, par le jeu admirable d'un Nakadai au sommet et d'un Natsuyagi Isao qui réussit à aller outre que son rôle de samouraï libre dans l'inégale mais amusante série des Kiba. Cette histoire d'amitié entre ces deux hommes, le raliement des clans Kannon et Enokiya trop beau pour être vrai (et pour durer), les faux-semblants une nouvelle fois bien présents (dont deux superbes femmes meurtrières), le déséquilibre de la société et la dangerosité des "on-dit", le retour malvenu de Tsutomu aimé d'une femme qu'il a largué après sa sortie de prison et surtout le background noirissime qui inscrit véritablement Les Loups dans la veine pessimiste mais réaliste de Gosha.


De ce fait, le soir du Festival (s'étalant sur la dernière demi-heure du film) est le moment clé pour le basculement du film dans la violence : rythmé au son des flûtes et percutions traditionnelles, Nakadai devient chasseur, à un moment donné où sa présence commençait à se faire rare à l'écran, comme s'il s'effaçait pour mieux rebondir et sortir les crocs. Le film est d'ailleurs ponctué, mais plus rarement que sa dernière demi-heure, d'affrontements particulièrement violents et bien mis en scène : cadrages rigoureux, recul et plans plus étirés qu'avant (annonçant en filigrane son nouvel élan artistique avec Yohkiro) donnant un vrai souffle au film et au spectateur justement de manquer de souffle face à ce qu'on appellera un travail de pro. Pour prendre un exemple, la scène où les deux femmes tueuses étranglent et trainent leur proie sur le sol évoque deux araignées face à une mouche prise dans leur toile, cette séquence terrifiante est sans la moindre musique, et la caméra de Gosha suit progressivement par l'intermédiaire de gros plans sur le visage de la victime les tribulations démoniaques des deux monstres. Et les séquences silencieuses terrifiantes ne manquent pas. La musique de Sato Masaru est aussi marquante (dont un superbe thème qui revient à trois ou quatre reprises durant les moments clés) parce qu'elle est juste belle, variée et inspirée notamment dans son dernier tiers où la musique de la fête accompagne la violence des duels à l'arme blanche, en fond sonore discret mais bien présent qui ironise (ou décuple, c'est selon) les séquences brutales. En bref Les Loups est de ces Gosha encore invisibles qui mériteraient d'être bien plus mis en valeur, l'un des plus importants car l'un des plus complets aussi bien sur le plan thématique, formel que politique, sombre comme ces loups qui finiront tous par chuter. C'est un peu le risque à courir...