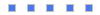

| Arno Ching-wan | 3.25 | Les idéaux d'Nakata |


… ou complexe d’infériorité par rapport au monumental Morse, Grand Prix 2009 ?
A l’apparente simplicité de The Water et Dark Ring (hum), Nakata charge cette fois son histoire de plusieurs couches, de plusieurs histoires collées qui en font presque, parfois, une sorte d’amas de mini films qui tenteraient de raccrocher les wagons aux succès horrifiques en vogue. Serions-nous là face à la manifestation d’un complexe d’infériorité de l’homme à l’origine d’une date dans le genre – The Ring, qui lui aura définitivement mis la bague au doigt – et qui se rend soudainement compte qu’il n’a rien de neuf à proposer dans ses bagages ? On a ainsi droit à un gros twist, excellemment bien construit, bien amené mais qui a un voire plusieurs trains de retards par rapport à la concurrence. On y trouve aussi comme autre wagon dévoyé un gros emprunt avoué au suédois Morse, grand Prix de Gérardmer en 2009, avec cette même camaraderie contre nature et ces scènes paisibles dans un parc pour enfants. Un peu trop compliqué, ce brassage? « Complex » veut dire cela, compliqué, complexe, en même temps qu’il renvoie au complexe d’immeubles, là où habite notre héroïne, Asuka, étudiante infirmière. Très jolie, évidemment. Elle y loge avec sa famille, de l'autre côté du palier l'on trouve un étrange voisin tandis qu’un petit garçon esseulé traîne dans les parages… A trop vouloir enrichir son histoire, à juxtaposer plusieurs vignettes en forme de passages obligés aisément détectables, Nakata se perd un peu dans les méandres de son complexe de structures narratives qui, tels des immeubles d’une cité surchargent le décor, la narration. Il complexifie tout un ensemble de trames qui, elles, sont archi simples, déjà vues. Et il l'assume, malin, en avouant avoir pondu une sorte de best of de sa carrière pour les 100 ans de la Nikkatsu. Il s'en sort bien mais on voit passer la rame. Alors, raté The Complex ? Aucunement. Nakata prend ses distances d’avec ses œuvres précédentes, manque d’y greffer sa personnalité - ce qu'il ne souhaite aucunement par ailleurs, il garde sa mentalité de soldat en se mettant au service d'un quelque chose - mais ça n’est en rien un échec. On reste dans le cadre de la série B de qualité emballée avec talent.
"Non papa. C'est toi qui va aller la ranger, ma chambre..."
Plusieurs scènes de flippe fonctionnent parfaitement, comme cette lente visite angoissante de l’appartement voisin, lugubre, ou bien encore tout le final, dont une séance d’exorcisme local qui, après le démon juif du Possédée du danois Ole Overdal participe de l’exportation d’un ésotérisme dépaysant. Il est si réussi, cet exorcisme (sur la forme ; je vous laisse juges du résultat sur le démon...), qu’on aurait aimé le voir prolongé, plus montré encore lors du climax à travers cette médium mémorable qui évoque, elle, la réussite à l’espagnole de L’orphelinat via le personnage de Géraldine Chaplin, ou encore celle, britannique, du très bon La maison des ombres à travers la magnifique Rebecca Hall. La scène renvoie aussi aux excès géniaux de la petite série anime Mononoke, un modèle actualisé en terme de mise en image – et de scénario - de ce type de scène. Nakata redevient aussi génie quand il se met à filmer le banal, le quotidien. On ressent quelque chose quand la jeune Asuka se promène dans son quartier, un spleen prégnant, on éprouve davantage encore pendant ses exercices d’infirmière, avec cette crédible tranche de vie bien documentée, brisée par un effroi glacial très intelligemment conduit. On retrouve à cet endroit les secrets de la réussite de L’exorciste de Friedkin, l’approche clinique du documentaire qui précède l’intrusion du romanesque. On appréciera la discrétion des effets sonores, l’absence de style m’as-tu vu souvent déballé ailleurs, l’art de l'ellipse, quelques instants doux bienvenus et un fantôme qui, à moi, m’a donné la chair de poule. L’horrible vieillard renvoie autant à notre propre mort qu’à la tronche cauchemardesque de la mère des soupirs chez Argento, ou encore au final du très bon L’exorciste, la suite, en plus de souligner un fait de société, la solitude dans les grandes villes et cette mort d’un oublié qui peut se produire à l’insu de tous. Ce phénomène n'est pas propre au Japon, il ramène à plusieurs faits divers que nous connaissons, que nous n’oublions pas parce qu’ils nous ramènent à notre propre culpabilité collective ainsi qu’à notre hypothétique fin, pathétique. Nakata fait honneur à sa réputation et frôle là un sujet cher à Kiyoshi Kurosawa tout en se l’accaparant intelligemment. The Complex n’aura pas l’impact des deux bombes précitées à cause de tout un tas de petites choses qui le plombent. J’en ai moi aussi ma claque des enfants démoniaques, le final ouvert est aussi plaisant qu’il peut énerver, passer pour une facilité d’écriture, la redite par rapport à Dark Water, cette poubelle en lieu et place d’un réservoir d’eau, est particulièrement gênante, les acteurs ne sont pas toujours dans le ton. Si la pulpeuse Atsuko Maeda, ex idole du groupe AKB48 s’en sort plutôt bien – sans plus –, de son côté Hiroki Narimiya m’est gentiment sorti par les yeux avec son jeu approximatif et son physique plus proche de celui d’un gigolo gay que d’un crédible brave nettoyeur lambda.
il faut reconnaître que The Complex fut plutôt moyennement aimé des festivaliers. Je me suis d’abord senti un peu seul à l’avoir apprécié, me demandant finalement si j’avais été honnête avec moi-même ou si je m’étais menti pour mieux anticiper l’interview qui allait suivre, que je voulais positive. Puis la rencontre de deux spectateurs, plutôt âgés, qui ont beaucoup aimé le film, m’a conforté dans ma vision des choses. Pas d’effets de style, pas d’exagérations sonores, une approche honnête et respectueuse du genre via un premier degré assumé, des scènes de terreur pure, quand même, et un scénario qui ne livre pas toutes ses clefs, en main ailleurs, cela fait un bien fou. Roublardise ou pas. Il prendra de la bouteille.


