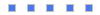

Eric Valette nous parle de son film Le serpent aux mille coupures. Quoi de mieux qu'une torture chinoise ancestrale en guise de passerelle asiatique ? On en trouve d'autres... Attention aux spoilers.
Résumé : Sud Ouest de la France, hiver 2015. Un motard blessé quitte les lieux d’un carnage. Le mystérieux fugitif trouve refuge chez les Petit, une famille de fermiers qu’il prend en otage. A ses trousses : des barons de la drogue colombiens, le lieutenant colonel Massé du Réaux, et un tueur à gage d’élite, qui sont bien décidés à le neutraliser, par tous les moyens. L'homme a déclenché une vague de violence dont personne ne sortira indemne…

— Ciné nazi ? (rires)
— Euh... non (rires). Encore que d'ici un mois, il va certainement falloir s'adapter, oui.— Il faut savoir rester souple.
— Qu'est-ce que ça fait, d'ailleurs, de présenter ce film à Beaune un mois avant les élections présidentielles?
— Je ne me suis pas posé la question du tout. C'est un film que je voulais faire depuis la sortie du bouquin. On parle de 2009-2010. Le fait que ce film arrive dans ce timing là est totalement fortuit, même si on a essayé par rapport au contexte du bouquin, qui se passe en 2001, juste après les événements du 11/09, d'apporter quelques éléments peut-être un petit peu plus modernes. Notamment dans la façon dont le problème du racisme a été abordé, à savoir qu'il s'agit davantage d'un problème de paupérisation des campagnes dans ce film contre un peu plus de racisme virulent dans le bouquin. J'ai essayé d'amener l'idée que le fait que le type soit noir n'était pas forcément déterminant, que c'était juste la cerise sur le gâteau. Une forme de jalousie. On peut raconter le même type d'histoire avec un blanc. Qu'il soit noir venait s'ajouter à un lot de frustrations de la part des paysans de la meute.
— Quelle aurait été la différence, s'il avait été blanc ?
— Le fait qu'il ait réussi, tout bêtement. Un peu mieux réussi qu'eux. Et qu'il se soit marié avec une fille du coin.
— On aurait rejoint le cinéma de Peckinpah.
— Les chiens de paille, oui. J'aimais bien l'idée qu'il n'y ait pas que l'élément xénophobe au coeur de la problématique. On trouve quelques dialogues qui mettent en exergue que ces mecs-là sont atteints, dans leur quotidien, par les ravages de la globalisation.
— J'ai relu un entretien où tu disais qu'il fallait être amoureux de ses personnages. On en trouve au moins un, dans ce film, avec lequel on se demande comment c'est possible.
— Quand je dis "amoureux", c'est en tout cas être fasciné par ses personnages, et toujours essayer de leur rendre justice dans la façon dont on les traite et on les filme. Ce qui m'amuse et me séduit dans le personnage de Tod, c'est qu'il s'agit d'un type qui a une volonté suicidaire tout du long et qui l'accomplit. Les suicidaires ont toujours un petit côté émouvant, même si là il emporte quand même beaucoup de gens avec lui (rires), mais je trouve qu'il y a une grâce dans sa façon de faire les choses qui a un côté fascinant.
— Terence Yin use d'un petit sourire en coin marquant. Est-ce lui qui l'a amené ?
— Oui, en effet. On en a discuté, et moi ça me plaisait.

Tod (Terence Yin) hilare.
— J'ai même l'impression que lorsqu'il meurt, il l'a.
— Exact. On a fait une prise avec et une sans.
— Dès qu'il arrive en France, son personnage Tod dit qu'il est là pour le plaisir. L'accompagnes-tu dans cette démarche exutoire ?— Je ne suis pas un sadique, mais j'apprécie de le suivre, pas uniquement pour les choses dans lesquelles il excelle, tuer, mais aussi parce que c'est un poisson hors de l'eau. Hors contexte, ils sont amusants, parce qu'ils amènent leur identité, leur énergie, en étant délocalisés. C'est intéressant parce que quelque part ce personnage amène aussi un petit peu de polar coréen, dans un film qui pourrait être à la Yves Boisset, par exemple.
— A quels polars coréens penses-tu ?
— Il existe une méthode de travail, certes, mais c'est aussi lié au plaisir de retrouver des gens qu'on apprécie, de s'amuser avec eux. lls ne viennent pas pour l'argent. Ils viennent parce qu'on a une relation avec eux, parce qu'on leur propose un projet qui sort un peu des clous. Evidemment, ils ne viennent pas gratuitement, mais par contre ils ne viennent pas cachetonner. Ils sont là parce qu'il y a quelque chose d'intrigant et d'original dans le projet.
— Gérald Laroche est là depuis Maléfique, Stéphane Debac depuis La proie. Si ce dernier joue excellemment bien le chafouin, Gérald Laroche semble se rapprocher d'un français moyen un peu bougon, mais observateur, au potentiel positif. Son personnage sauve la morale du groupe.
— Tout à fait. C'est celui qui dénonce, mais dans le bon sens du terme (rires).
— La façon dont le policier en parle montre que ça n'est pas de la délation pure.
— On trouve ça dans le roman de DOA, je ne l'ai pas inventé, mais j'avais plaisir à ce que ce personnage soit joué par Gérald. Il apporte une dignité là-dedans. J'ai du mal à le projeter dans un rôle plus monolithique en fait, parce que c'est quelqu'un qui porte sur son visage tellement d'angoisses. C'est difficile d'en faire un méchant, me semble-t-il. Je crois qu'il l'est dans la série d'Olivier Marchal, Section Zero.
— On retrouve aussi Pascal Gregory, que j'aime personnellement beaucoup depuis Nid de guêpes.
— Ce que j'aime avec ce type de choix de casting, de faire Laroche, Gregory, Sisley, Terence Yin etc, c'est qu'il y ait plein de familles différentes qui se retrouvent, et non uniquement celle des acteurs commerciaux par ici, celle des acteurs d'art et essai par là, de télé par ici...
— Tomer Sisley a fait des gros films. Largo Winch...— J'aime cette idée de rencontre des gens. Tomer, typiquement c'est le genre de personne dont je ne suis jamais sûr du coup quand je vois Largo Winch, parce qu'il véhicule quelque chose de trop rayonnant, séduisant, positif par rapport au personnage de motard tel qu'on le lit dans le roman de DOA.
— Il est surprenant ici.
— Je trouve qu'il a cette noirceur. Il a la noirceur et l'ambiguïté du rôle. Il faut être curieux, le voir dans Nuit blanche, par exemple. Il a déjà une forme d'intensité, sans qu'il soit aussi sombre que dans Le serpent (...). Il y joue un flic à moitié ripou, un personnage sous tension. Il ne faut jamais mettre les gens dans des cases, ils ont très envie d'en sortir, mais le système ne les y encourage pas.
— Six ans entre La proie et celui-là. C'est long, malgré les séries télé.
— Oui, j'ai fais beaucoup de séries télé entretemps, j'ai travaillé sur d'autres projets qui ne se sont pas faits. Le principe c'est d'avoir toujours deux ou trois projets qui rencontrent leur alignement d'étoiles au bon moment. Ca a souri pour Le serpent à partir de 2004. Le film avait vraiment beaucoup de mal à se monter, et avec l'aide d'un nouveau producteur qui s'est joint à notre farandole, on y est arrivés. Ce qui est un peu la réalité économique des films français. C'est difficile pour le cinéma de genre, mais même des gros films de type Boule & Bill ou LA French sont tournés aux 3/4 au Luxembourg ou en Belgique [Le serpent a en partie été tourné en Belgique, NDLR]. Pourtant, a priori ce ne sont pas des films qui manquent d'argent.
— Ce qui me rappelle la dynamique des Bee Movies à l'époque de Maléfique, dont on croyait qu'elle allait faire naître quelque chose.
— Ca se délite, mais c'est passé par des phases. Olivier Marchal a reboosté le polar en salle, au début des années 2010 c'est retombé, et actuellement on se place dans une phase de recomposition du paysage qui est difficile à cerner. Franchement, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas exactement comment les films vont être financés. J'ai juste une impression, c'est qu'on ne peut pas soutenir indéfiniment un système qui diffuse deux comédies par semaine, voire trois parfois. A un moment, il va falloir proposer un peu de diversité au spectateur. Le cinéma ne peut pas se réduire à la simple comédie, particulièrement sous un angle très traditionnel comme la comédie romantique. La mécanique de l'ombre, c'est le seul film policier qui soit sorti depuis le début de l'année.
— Le Belge Bouli Lanners a lui aussi réalisé un polar rural, dans ma Beauce d'ailleurs, Les premiers, les derniers. De penser à lui m'évoque sa photo très belle de la campagne. La vôtre n'est pas en reste.
— Jean-François Hensgens vient à la fois d'un cinéma très commercial et du cinéma d'auteur. Il est très schizo, il fait Banlieue 13 Ultimatum comme tous les films de Joachim Lafosse, donc il est habitué de Cannes. Il a fait les derniers films de Dominik Moll également. C'est quelqu'un de très soucieux du grain, de la palette de couleurs. On s'est bien amusés à faire des nuits très sombres et à mettre des bleus pâles, des verts, enfin des couleurs qui soient séduisantes et qui ne soient pas trop datées, on espère.
— As-tu ressenti un challenge à relever en terme de polar rural ? Outre Les premiers, les derniers, Je pense à Total Western, Canicule, Carnage aux USA, et même Un faux mouvement, revu il y a peu suite au décès de Bill Paxton. J'ai pensé à ce film pour ce même final très sec.
— C'est marrant, j'ai justement sorti ce titre sur une interview précédente. On parlait des films où il y a peu d'action, mais qui donnent l'impression d'être très rythmés à cause de la tension ressentie. Il y avait ce film dont on parlait pas mal avec le producteur, il y a très longtemps quand le projet est né, que depuis j'avais un peu oublié et qui aujourd'hui revient à l'esprit : Un faux mouvement. Justement parce qu'il a cette structure un peu en entonnoir où tout converge vers une explosion finale. Mais les choses n'y sont pas pour autant précipitées. Quelques éclairs de violence parsèment le film, mais ça n'est pas un truc super haletant, on n'est pas tout le temps pied au plancher. A la fin, on n'a pas de quatrième acte non plus, où ça n'en finirait pas de finir. J'aime bien l'idée que les confrontations soient réduites à quelque chose de très hiératique et épuré. Un faux mouvement était un bon exemple de ce type de structure.

Au second plan, un paysan a comme un gros coup de pompe.
— La confrontation commençait dans la ferme, après il y avait une poursuite en voiture qui traversait un marché, genre années 70 avec des cageots qui volaient. Ensuite les deux voitures finissaient devant le cloître de Moissac, et à l'intérieur, dans cette bâtisse historique, se tenait une dernière fusillade. C'est moi, non DOA, qui ait procédé à ces aménagements.
— Pour des raisons de budget ?
— Absolument, pour ne pas exploser les décors. Après l'avoir fait, je me suis dit que ça n'était pas si mal dramatiquement parlant parce que tout converge vers la ferme. C'est sans doute plus dense que d'amener le public sur une sorte de leurre où l'on en rajoute alors que si l'on fait à confiance à la dramaturgie, à l'action, la confrontation façon western est intéressante.
— Avec ce cow-boy comme caché derrière un abreuvoir, pendant la fusillade.— Là, j'ai pensé à un western, Open Range, que j'admire beaucoup.
— De parler western nous permet d'évoquer la musique du film, qui commence un peu comme du Tangerine Dream, avec des sonorités électro auxquelles un peu plus tard vient se greffer une guitare et des riffs aux accents de rock sudistes. Les compositeurs ont-ils proposé ça ou y as-tu mis ton grain de sel ?
— Au fur et à mesure que le motard s'humanise, je m'étais dit que ce ne serait pas mal que des choses nous amènent vers son intériorité, parce qu'il ne l'exprime pas. J'ai adjoint au compositeur Mike Theis - qui est un breton, comme son nom l'indique - pour deux ou trois thèmes épars dans le film mon compositeur anglais Noko [Norman Fisher-Jones] qui a fait les guitares. Donc, les guitares viennent d'Angleterre. On a mixé ça avec des gros sons électro derrière.
— Si je ne m'abuse, c'est flagrant lors du tête-à-tête avec le chien, dehors. On voit deux animaux qui se reniflent, d'une certaine façon.
— C'est ça, un loup solitaire et un chien (rires). Le morceau s'appelle Stray Dog. Ce passage est l'un de mes moments préférés dans le film. C'est très émouvant. Et comme il suit la scène de torture, on se dit peut-être que le gars qui a fait ce film n'est pas complètement maniaque, finalement (rires).
— Attente, campagne et gunfights me font penser au gunfight du milieu de A Hero Never Dies et au final de Triangle. Si en l'occurrence tu évoques plus volontiers le western, sont-ce des films que tu aimes, qui font partie de ton bagage ?
— J'aime beaucoup Johnnie To donc c'est un grand compliment. Par contre, si j'apprécie A Hero Never Dies, je suis encore plus fan de sa veine ligne claire Melvilienne: PTU, The Mission, Life Without Principles, Election 1 & 2 ou même Vengeance. Le polar HK était et reste encore un peu, même si le contexte est plus dur, une des mines créatives du genre ces dernières décennies.— Oui. J'avais un temps pensé à Nick Cheung, Simon Yam également, que j'ai pu rencontrer à Hong Kong. Simon Yam n'était plus libre pour nos dates, mais de toute façon ç'aurait été autre chose, il aurait incarné un Tod plus vieux. Terence, je l'ai repéré dans une séquence très marquante pour la peine. Effectivement, sa filmo est souvent très anonyme, mais il a une séquence très forte dans le film de Johnnie To, Une vie sans principe. A un moment donné, il joue un caïd de la mafia à qui des types doivent de l'argent, et il en torture un avec une fleur métallique. Il était assez impressionnant dans cette scène. Après, je l'ai vu en méchant dans des films de Takashi Miike où il était second couteau, c'était vachement intéressant. Puis après avoir pas mal discuté avec lui sur Skype, le fait qu'il parle parfaitement anglais, ce qui n'est pas si commun chez les acteurs chinois, m'a emballé.

Terence Yin ose menacer Lau Ching-wan dans le Life Without Principle de Johnnie To.
— Que l'on parle en anglais dans le film, est-ce une ouverture pour une exportation du film ?
— Non, il parle anglais dans le roman. Enfin, c'est écrit en français, mais il parle anglais (rire). Il est vrai que la multiplicité des langages dans le film est plutôt favorable à l'export. Ca donne un petit côté international au film, en même temps qu'il est complètement ancré. Chaque personne parle le langage qu'elle doit parler.
— On voit en effet dans le roman tout cet extérieur qui s'invite dans ce petit village au fin fond de la cambrousse française.
— Oui, c'est ça, comment le très grand influe sur l'infiniment... petit (rires) ["Petit", c'est le nom des fermiers brimés, ndlr].
— Après la séance, j'en entendais certains s'interroger sur l'identité du motard, joué par Tomer Sisley. Ceux qui ont lu Citoyens clandestins savent ce qu'il en est, et quelques pistes sont disséminées dans Le serpent (l'homme sans nom qui appelle le gendarme"Mon colonel", etc...).
— DOA dans le bouquin ajoute quelque chose comme "Et Lynx s'éloigne..." et le lecteur a compris [vérif : "je suis la raison d'Etat. La chimère que le bon peuple ne doit jamais voir" (...) "Lynx mourrait pour de bon et le laisserait enfin recommencer sa vie"]. Dans le film, ça n'est pas possible. J'avais lu le bouquin d'avant, donc je n'étais pas vierge du tout, mais je pense aussi que le bouquin, quand tu le lis comme ça hors contexte, tu n'as pas vraiment de problème. D'ailleurs, ce livre, en l'état, est très proche de la structure même d'un scénario. Un peu comme certains livres de Manchette, qui n'est pas sans rapport avec DOA. Sauf que Manchette a peut-être une tendance plus affirmée vers l'humour absurde.
— Manchette est aussi peut-être un peu plus gauchisant.
— … et droitisant chez DOA, qui éprouve en plus une fascination pour les militaires, les armes, etc. Manchette est plus foutraque et anar d'une certaine façon. Mais ils ont en commun un sens de l'action, du rythme, des personnages. C'est percutant et rythmé dans l'écriture.
— J'ai relu il y a peu l'adaptation en BD signée Tardi de son Ô dingos, Ô châteaux ! C'est toujours aussi puissant. Il faudrait le basculer au cinéma un de ces jours... (*)
— Je sais. Ce n'est pas faute d'avoir été sur les rangs, et je l'ai toujours derrière la tête.
— On dit souvent d'un écrivain qu'il rechigne – ou peine – à adapter son livre pour le cinéma.
— DOA l'a fait en l'occurrence. En ce qui me concerne, j'ai réajusté son travail à des conditions budgétaires et logistiques, procédé à des aménagements par rapport à des décors, fait que certaines choses coûtent un peu moins cher.
— Parlons chiffres, justement. Budget, jours de tournage, nombre de salles ?
— 2,5M environ, pour 34 jours de tournages (30 pour Maléfique). 32 salles confirmées à ce jour.
— J'avais peur que ce film bascule directement en VOD.
— Ca n'était pas exclu, il en avait le profil. Un peu comme Made in France de Boukhrief.
— (Sur un ton pince-sans-rire) Ce sont des cadavres de récupération loués sur le marché de l'occasion du corps de films. Il y a très peu de gens qui ont du stock en terme de corps, et on ne pouvait pas mouler, ça coûte trop d'argent. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de récupérer du corps, à la fois brûlé, et pour la fille. On a loué des trucs chez un ami. C'était très drôle, je faisais le marché : un bras gauche s'il te plaît, et un pied. Ah ! Féminins, hein ! On a fait une montagne de membres.
— Dans Crime à froid de Bo Vibenius, par exemple, la légende dit que le plan de l'oeil crevé a été effectué sur un vrai cadavre.
— Ce sont des faux membres, et on a mis la tête de la véritable actrice dessus. Mouler un visage, ça coûte très cher. David Scherer, créateur de SFX, n'a pas travaillé sur ce film, mais il nous a aidés.
— Un cinéaste a dit un jour que s'il ne l'était pas devenu, il aurait pu être serial killer.
— Je suis sociopathe, mais pas tueur en série !
— De voir un acteur HK à l'origine de scènes bien trash renvoie aux films de Cat III hongkongais. Y as-tu songé ? Si oui, lequel(s) pourrait se voir "satellisé" autour de ton film ?
— Je n'ai pas spécialement pensé à la Catégorie 3 ni même à certains films japonais extrêmes type Takashi Miike qui rejoignent ce concept de "Catégorie 3". Par contre, il est clair que la culture des acteurs en Asie fait qu'ils sont accoutumés à ce genre de scènes et qu'ils n'en font pas une montagne de questions existentielles. C'était le cas de Terence Yin, qui n'avait strictement aucun problème à les tourner. Par ailleurs, c'est quelqu'un de très agréable, qui a grandement apprécié les spécialités locales, les plats toulousains et même le vin de Gaillac !— Son temps de présence à l'écran est-il supérieur à celui de Tomer Sisley ?
— Je n'ai pas fait le compte, mais on ne doit pas être loin de la parité.
(*) Erratum : déjà adapté en 1975 par Yves Boisset. Folle à tuer, avec Marlène Jobert et Tomas Milian. A découvrir, donc, en plus de souligner ce cousinage évident Boisset/Manchette et Valette/DOA.
