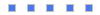
Une mythologie des ténèbres, de l’étrange au monstrueux
Dans le continent encore largement inexploré que constitue en France (amateurs et détracteurs réunis) la bande dessinée japonaise contemporaine, l’œuvre de MOROHOSHI Daijirô se présente comme un territoire aussi peu accueillant que dérangeant, aussi abrupt que fascinant.
Pléthorique, foisonnante, l’œuvre de MOROHOSHI s’organise en un certain nombre de directions et thématiques, recoupant autant de registres génériques cardinaux de la production dessinée japonaise : récits fantastiques, d’horreur, de science-fiction, mythologiques, historiques… Dessinateur au travail inscrit dans le cadre traditionnel des magazines de prépublication à grand et moyen tirage, loin des revues de bande dessinée indépendante ou « alternative » où il aura fait ses débuts, il apparaît pourtant comme profondément singulier dans son parcours comme dans son rythme de publication au sein d’un cadre éditorial avant tout commercial. Auteur de séries longues (au point que le mot semblera faible), il est tout aussi connu — sinon davantage — pour ses très nombreux récits brefs, qui tissent en eux-mêmes un univers propre, d’envergure monumentale, et constituent quasiment une œuvre à part entière. Autant de clivages qui, parmi tant d’autres, montrent bien les limites de telles catégories (« domaine commercial » contre « production d’auteur », « série en feuilleton » contre « récit auto-conclusif »), appliquées en tant qu’a priori au domaine japonais.
Un survol d’ensemble de sa bibliographie révèle l’équilibre instable dans lequel s’inscrit sa carrière presque toute entière, dans un système éditorial où le rythme de création hebdomadaire est une norme fréquente. De fait, un certain nombre de ses séries en feuilleton se plient à ces exigences de parution, mais les changements d’éditeur, voire les à-coups et arrêts temporaires en cours de parution d’un même feuilleton, sont monnaie courante dans son parcours.
Autodidacte, MOROHOSHI n’est en rien dessinateur de formation ; ses récits sont avant tout des concentrés de narration, où lui ou l’un de ses personnages se fait volontiers le conteur d’événements édifiants. D’emblée, et par inclination naturelle, l’étrange et du surnaturel sont en effet les domaines de prédilection qu’a investi sa création.
N’étant a priori pas passé par le système usuel au Japon de l’assistanat, il n’utilise pas lui non plus d’assistants, mais travaille seul. Peu loquace, il est souvent taxé de misanthropie ; connu pour son peu de goût des rencontres publiques et des entretiens, il reste d’une grande discrétion dans ses déclarations. Pour autant, ses interventions, souvent laconiques, sont toujours le fruit d’une réflexion soigneusement pesée, d’un effort de formulation conséquent.
Mais surtout ses œuvres, par leur autonomie et leur envergure propre, se passent aisément d’un commentaire de leur auteur, et ont d’emblée suscité dans son pays une admiration unanime et constante, auprès des observateurs les plus divers, créateurs (de TEZUKA Osamu à MIYAZAKI Hayao) comme critiques (de KURE Tomofusa à NATSUME Fusanosuke), un terme en particulier revenant dans presque tous les commentaires : celui de « génie »…
Né en 1949, benjamin d’une famille de quatre enfants, MOROHOSHI est originaire de Tökyô, où il grandit dans le quartier populaire d’Adachi. Comme pour tant d’enfants de sa génération, les récits dessinés de TEZUKA Osamu — et au premier chef Tetsuwan Atomu (Astro) — marquent profondément le jeune lecteur qu’il est alors. À sa sortie du lycée, il entre directement dans la vie professionnelle, comme fonctionnaire municipal.
Ses débuts en bande dessinée, fin 1970, semblent presque dus au hasard : après trois ans de carrière dans la fonction publique, il démissionne pour se lancer dans la bande dessinée. Au printemps de la même année, il avait envoyé à la revue « COM » un récit de science-fiction apocalyptique d’une douzaine de pages, Kinka wo irete kara botan wo oshite kudasai (Introduisez la monnaie puis appuyez sur le bouton) qui se voit publié parmi d’autres envois de lecteurs (1). En décembre, un second récit, Junko – kyôkatsu (Junko — chantage), est à son tour récompensé dans les pages du même magazine, et marque officiellement son entrée dans cette profession.
Les années suivantes le voient publier quelques rares récits, notamment dans le hors-série du magazine « Action » des éditions Futabasha, En 1974, le récit Seibutsu toshi (la Cité organique), paru dans l’hebdomadaire « Shônen Jump » des éditions Shûeisha, est couronné du 7ème Prix Tezuka ; commence alors véritablement une carrière prolifique, à travers de multiples supports. Citons, pour la même année 1974, Yume miru kikai (Machine qui rêve), un récit bref à la trame inscrite dans la lignée de l’âge d’or de la science-fiction américaine des années 1940-50, au traitement psychologique original ; en 1976, Adamu no rokkotsu (la Côte d’Adam) et Seimei no ki (l’Arbre de vie) sont deux récits d’argument biblique dénaturé, le second faisant entrer en scène l’investigateur du surnaturel Hieda Reijirô, figure récurrente de nombreux récits ultérieurs, épars au fil des ans et auto-conclusifs, comme autant de pièces d’un puzzle de longue haleine, et réunis notamment sous l’intitulé générique Yôkai hantâ (Chasseur de spectres).


Mais surtout, ces premières années sont marquées par deux feuilletons parus en épisodes hebdomadaires très ramassés dans « Shônen Jump » : Ankoku shinwa (le Mythe de la divinité des ténèbres), en six livraisons (mai-juin1976), puis Kôshi ankoku den (Vie de ténèbres de Confucius), en dix épisodes (décembre 1977-février 1978). Ces deux récits, les tout premiers de sa carrière à paraître également en volumes, dévoilent un autre versant du talent de conteur de MOROHOSHI : la densité de constructions dramatiques à la progression sans répit, et l’audace générique de jeux spéculatifs et d’un sens du mélange vertigineux qui perd son lecteur entre références historiques, religieuses et mythologiques voire cosmogoniques… Ces lignes de forces se retrouvent dans nombre de récits postérieurs, quelle que soit leur longueur.
Les récits brefs Kodomo no asobi (Jeux d’enfants) et Fukushû kurabu (Vengeance Club), parus tous deux en 1979, illustrent une autre veine créative, inscrite dans le quotidien contemporain le plus banal, qu’elle fait basculer dans une horreur où viennent se confondre l’ordinaire et l’extraordinaire… La fin des années 1970 voit aussi MOROHOSHI se lancer dans une autre série d’envergure, celle des Maddomen (Mudmen), feuilleton de longue haleine où se mêlent notamment mythes et croyances du Japon et de Nouvelle-Guinée.
Entamée en 1981 dans l’hebdomadaire « Young Jump » de Shûeisha (elle ne s’achèvera que bien plus tard, dans les années 1990, et chez un autre éditeur), la série Kaishinki (Chronique des divinités marines) revient vers l’exploration historique des mythes du Japon ancien, tandis que l’auteur, passé d’un public enfantin aux revues pour adolescents et pour adultes, multiplie les récits brefs en tous genres dans les supports les plus divers.

En juin 1983 paraît dans le mensuel « Super Action » des éditions Futabasha le premier épisode de Saiyû yôen den (le Voyage en Occident d’un singe mystérieux), à ce jour l’œuvre la plus ambitieuse de MOROHOSHI, par son ampleur comme par le matériau originel qu’elle adapte — le fameux Pèlerinage en Occident, un des romans les plus fameux de la littérature chinoise, à la popularité jamais démentie au Japon.
De toutes les adaptations dessinées à ce jour au Japon de ce grand classique chinois, l’œuvre de MOROHOSHI est la seule à s’imposer par une réelle indépendance créative, et la seule à se hisser ainsi à hauteur égale de l’œuvre originelle, sortant tout à la fois d’un rapport de dépendance réducteur, et d’une forme de référence gratuite, par simple prétexte, sans consistance réelle.
Les personnages de cette série fleuve sont proprement innombrables. Ils traversent le récit, les uns en coup de vent, emportés par les péripéties de combats et de tueries incessants, les autres aux apparitions plus régulières, mais souvent voués eux aussi aux destins les plus cruels. Les destins qui se bousculent ainsi sous les yeux du lecteur confinent parfois au grotesque, voire au gore le plus cru. D’une noirceur désespérée dans sa description des ambitions et de la cruauté humaines, MOROHOSHI illustre ici dans le registre de l’épopée mythique une vérité essentielle à toute conscience rétrospective, à savoir que « l’Histoire, c’est avant tout l’histoire du crime ». Le même constat s’imposerait d’ailleurs à l’égard de toute mythologie, voire sans doute de toute superstition.
L’histoire même de la parution de ce titre « maudit » mériterait d’être contée pour elle-même. Car cette fresque monumentale, prévue par son auteur en quatre grands volets, est toujours loin d’être achevée à ce jour. Et si Futabasha, jusqu’en septembre 1987, publie une part du premier volet, la parution qui s’interrompt alors, reprend ensuite à peu près régulièrement, de mai 1988 à avril 1990, dans le hors série mensuel « Action Comic Character », avant une seconde pause. Puis, en mars 1992, la série réapparaît dans la revue « Comic Tom » des éditions Ushio, où se conclura le second volet en 1997. Depuis la parution du volume 16, en 2000, le récit n’est toujours pas achevé, et ses lecteurs, en attente de la prochaine reprise de sa parution, ne peuvent que s’armer de patience pour la suite de cette grande saga fantastique.
En cette même année 2000, MOROHOSHI se voit d’ailleurs couronné du 4ème Prix culturel Tezuka Osamu (une récompense fondée en 1997 par le grand quotidien Asahi) pour le grand-œuvre en devenir qu’incarne dans son parcours Saiyû yôen den. Par ailleurs, durant toutes ces années voire ces décennies, les parutions de récits brefs et de séries, tout comme les publications de volumes et les rééditions en tous genres, se sont poursuivies selon un rythme ininterrompu.
La dernière série en date de l’auteur est une surprise des plus réjouissantes : entamée en 1995, et destinée à un lectorat féminin, elle conte les aventures de Shiori to Shimiko (Shiori et Shimiko), deux lycéennes vivant dans un quartier infesté de divers phénomènes et présences surnaturels. La série, publiée dans un bimestriel de bande dessinée fantastique pour les filles des éditions Asahi Sonorama, « Nemuki » (pour Nemurenai yoru no kimyô na hanashi, « Histoires étranges pour nuits d’insomnies »), compte à ce jour une quarantaine d’épisodes, et cinq volumes parus. Suspendue ces derniers temps, la parution doit reprendre en novembre prochain.
MOROHOSHI croise ici horreur et humour noirs en un mélange là encore singulier, où l’angoisse le dispute aux éclats de rire. Il se joue avec malice des attentes de ses lecteurs et lectrices, innove et mélange sans complexe ses motifs les plus familiers à un cadre et à des personnages résolument neufs, déroutants ; par là même, il acquiert un nouveau public, tout en étonnant l’ancien.
Par-delà les inventions qui parsèment chaque livraison (là encore auto-conclusive), les deux personnages principaux constituent une véritable révolution chez cet auteur dont les héros, même les plus récurrents jusqu’alors, ne permettaient pas au lecteur de ressentir de véritable empathie. En effet, là où les protagonistes de ses récits, distants de leur lecteur par la force des choses et de genres impitoyables, et à la survie elle-même sujette à caution, se sont souvent limités à de simples vecteurs obligés du récit, ces deux lycéennes, par leur répondant et le contraste de leurs personnalités, forment un duo féminin aussi amusant que naturel, et incarnent ainsi les personnages les plus attachants de leur auteur à ce jour.
L’œuvre de MOROHOSHI s’inscrit toute entière dans une forme de noirceur que peu d’autres dessinateurs ont égalé au Japon ; plus noir et plus violent que MIZUKI et TSUGE, plus radical et curieux qu’UMEZU ou ITÔ, plus nihiliste et distancié que NAGAI et MATSUMOTO, MOROHOSHI retrace tout simplement en permanence le franchissement d’une ligne ténue, mais qui trouve un écho en chacun de ses lecteurs : le moment où l’angoisse ou la peur cessent d’être un jeu (ce qu’elles sont trop souvent), pour prendre leur vrai visage, celui de la simplicité et de la banalité affolantes de l’horrible, de l’atroce donnés comme tels, sans ménagement ni fioritures, sans salvation ni catharsis. La violence, l’absurde noirceur du monde sont chez MOROHOSHI des données premières, qu’il est souvent inutile même d’évoquer tant elles sont évidentes ; ces postulats, ou plutôt ces constats objectifs, courent à travers tous ses récits, comme des lignes de trame préalables à toute composition.
Il y a quelque chose de lovecraftien chez MOROHOSHI, dans cette exploration à la fois vaste et éclatée, éparse et cohérente, presque combinatoire, des variations possibles au sein d’un même cadre thématique — ou plutôt ici d’un ensemble de tels cadres. Un ton commun qui réjouira sûrement les critiques français avides de raccourcis auteuristes. Si une lecture « auteurisante » n’a strictement aucun sens à se voir appliquer au domaine japonais de la bande dessinée dans son ensemble, il est certes des auteurs pour lesquels cette grille de lecture peut être utile et productive à certains égards. MOROHOSHI en fait clairement partie, et une vaste généalogie serait à retracer parmi ses récits, ses personnages et ses thèmes et motifs de prédilection. Car ce pur autodidacte s’est nourri dès ses débuts à maintes sources et références, à commencer bien sûr par l’histoire et l’ensemble des mythologies et croyances de son pays, par les études « auto-ethnographiques » japonaises (minzoku-gaku) comme par les grands mythes, épopées et récits de la Chine classique.
Là où MOROHOSHI dépasse LOVECRAFT, c’est dans l’usage qu’il réalise de son principal vecteur d’expression : de l’usage lovecraftien des mots, l’on retient d’abord ses cascades d’adjectifs plus frappants et grandiloquents les uns que les autres ; chez MOROHOSHI, le dessin, difficile à qualifier, ni habile ni malhabile, trace des personnages toujours déroutants, des décors chargés à l’encre, qui dédaignent le recours (usuel au Japon) au tramage pré-imprimé. Au final, il s’avère décisif dans l’impact même de ces récits, dont il prépare les basculements dans l’inconnu par un malaise visuel permanent.
Le graphisme de MOROHOSHI, qui noircit fréquemment son dessin de tracés accumulés en guise d’aplats, et pour exprimer des motifs unis, est ainsi marqué par la présence première d’un trait lourd, palpable, épais voire granuleux, éminemment lié au terroir, voire à l’élément terre dans sa dimension géologique et sa pesanteur étouffante (nombre de ses récits explorent d’ailleurs des profondeurs souterraines).
Quant à sa narration, basée sur une absence totale d’explication et un brio jubilatoire de jeu sur toute la gamme des diverses superstitions dont regorgent son pays et sa région du monde, elle passe par le prisme de personnages en proie à un désarroi constant, sans cesse renouvelé, et constituant un élément fondamental au registre du « fantastique » en tant que tel.
Inclassable, déroutant au point d’en apparaître redoutablement rétif à la critique et à l’exégèse, le travail de MOROHOSHI s’impose au firmament d’une bande dessinée iconoclaste, assumant tout autant si ce n’est davantage que celle de TSUGE, d’UMEZU ou d’ITÔ, une noirceur absolue, non dénuée par moments d’un humour à froid, mais oscillant toujours entre angoisse et terreur. Elle brille ainsi d’un éclat sans pareil, soleil noir au firmament de l’occulte et du surnaturel en bande dessinée. Reste, pour le lecteur comme pour le critique étranger, à se donner les moyens de la découvrir.
Ilan NGUYÊN
1) Dédiée à une production sinon « d’auteur », du moins inscrite dans une recherche graphique et narrative neuves, sous l’influence du gekiga et des créations publiées dans « Garo » (titre pionnier d’une « alternative » à l’hégémonie tézukéenne sur la bande dessinée japonaise d’après-guerre), la revue mensuelle de bande dessinée« COM fut fondée par TEZUKA Osamu (1928-1989) en 1967, en réaction précisément aux innovations de ton et de forme caractérisant « Garo », mensuel initié en 1964 par l’éditeur NAGAI Katsuichi (1921-1996).
Spécialiste du cinéma d'animation japonais dans son histoire et ses développements, Ilan NGUYÊN est aussi un critique reconnu de bande dessinée nipponne.
Merci à l'auteur et aux éditions Doki-Doki pour l'autorisation de reproduction.
Texte initialement publié dans le Dossier de Presse de l'édition française de Shiori & Shimiko.
